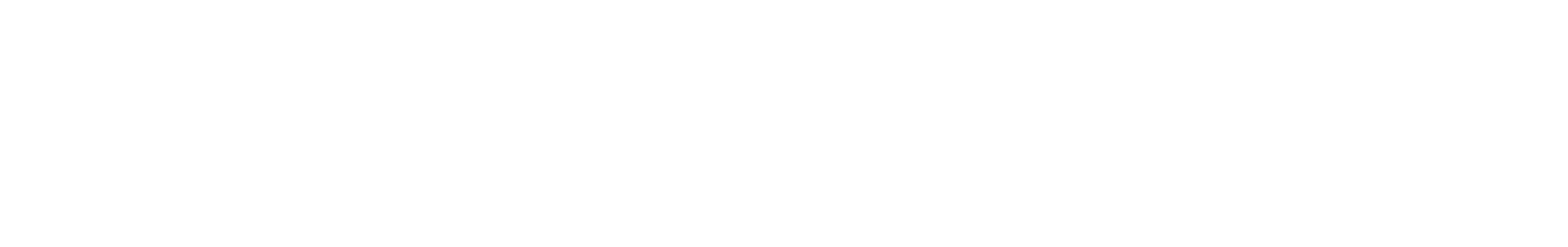Grand roman américain signé par une Française, “Les Âmes féroces” tient autant de l’étude psychologique que du polar et estomaque par son bouillonnement de récits comme les destinées blessées de ses protagonistes. Lauréate du Prix du Roman FNAC 2024, Marie Vingtras figure à l’affiche du festival Quais du Polar 20251. Conversation.
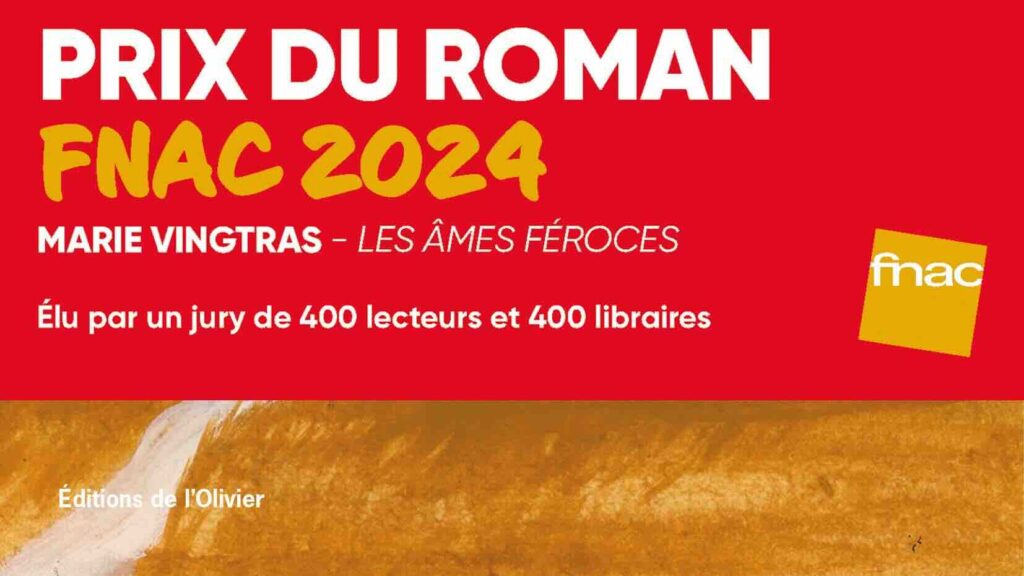
Pour les auteurs, la valeur d’un prix dépend aussi de ceux qui le lui remettent. Le Prix du Roman FNAC que vous avez reçu au début la saison des prix 2024 vous a été décerné par des libraires et des lecteurs. Cela a son importance…
Maris Vingtras : Il est assez unique, ce Prix FNAC : des prix de lecteurs ou de libraires, il y en a, mais il y en a peu qui mixent les deux. Évidemment que ce sont les prix les plus sincères et les plus jolis à obtenir, parce que les libraires et les lecteurs ne se demandent pas : « quelle maison d’édition ; est-ce un troisième, un deuxième ou un premier livre ? ». La question, c’est : « est-ce que j’aime ou pas ? » Et s’ils aiment, ils votent pour ce livre. Donc ça me fait très plaisir, après le Prix des Libraires que j’avais eu pour le premier [Blizzard, NDR], d’avoir à nouveau un prix, des libraires — et aussi des lecteurs.
Vous parlez dans Les Âmes féroces de l’Amérique. Mais comment le faire en ignorant ce qu’il va s’y passer ? Lorsque vous avez écrit ce livre, aviez-vous un œil sur ce calendrier ou bien est-ce fortuit ? Vous faites une description qui repose sur une étude et un regard sur cette société…
C’est un regard quotidien qu’on a tous : on est très imprégné par l’Amérique. C’est le pays qui a probablement le plus imprimé sa marque sur les autres pays du monde. Même un Afghan a une certaine idée de l’Amérique : les films, les séries, la manière dont on mange — moins bien qu’en France — sont américains. Et cette vie américaine, ces films de cow-boys que je regardais avec mon père quand j’étais petite, tout fait un agglomérat d’images, une certaine idée d’Amérique.
J’ai commencé à écrire ce livre en 2020 et j’ai fini à peu près en 2023, je n’avais pas en tête la politique américaine. L’actions se passe en 2017, donc techniquement, on est sous un mandat de Donald Trump, mais c’est une Amérique relativement figée : on n’est pas encore dans cette radicalisation sur laquelle je ne serais pas très à l’aise pour écrire, parce que je ne suis pas américaine. Mais oui, c’est un pays d’extrêmes, entre le meilleur et le pire au même endroit.
La “géographie” de votre livre reste volontairement assez vague…
Le premier, Blizzard, se passait en Alaska et on m’est tombé dessus en me disant : « vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas ». Ici, je me suis dit : « ne prenons pas de risques » (rires). J’ai situé celui-ci dans une petite ville américaine, Mercy, qui, à mon avis, n’est pas vraiment du Middle West. C’est une ville prospère, plutôt bourgeoise. on se rapproche quand même un peu de la côte Est. Il n’y a pas aux Etats-Unis de ville qui s’appelle Mercy, il y en a au Canada — donc c’était très pratique, ça m’évitait des procès d’intention.
Une grande ville est tout de même identifiée — mais parce qu’elle est cosmopolite, qu’elle peut être un peu fourre-tout : New York…
Oui. L’élément étranger dans cette petite ville vient de New York. New York, c’est encore le cas pour beaucoup d’Américains, est vraiment la ville de la dépravation, du vice, du bazar… C’est un peu une anomalie en Amérique, Ce n’est effectivement pas anodin.
Quand les gens viennent me voir en me demandant ce qu’il y a dans mon livre, je leur dis : « C’est pas un polar, c’est pas un thriller, je suis pas sûre que ce soit un roman noir… » Je finis par ne pas pouvoir le définir… Il paraît que je suis pas la seule à ne pas pouvoir nommer précisément ce que j’écris !
Marie Vingtras
Il est toujours délicat de ranger un livre dans une case. Mais puisque le personnage principal dès les premières pages est une shérif, considérez-vous stricto sensu ce roman comme un polar ou un roman noir ?
Non. Quand les gens viennent me voir en me demandant ce qu’il y a dans mon livre, je leur dis : « C’est pas un polar, c’est pas un thriller, je suis pas sûre que ce soit un roman noir… » Je finis par ne pas pouvoir le définir… Il paraît que je suis pas la seule à ne pas pouvoir nommer précisément ce que j’écris !
Il y a une femme shérif, il y a un corps au début, on se dit que c’est une enquête et puis, patratras ! à la deuxième partie, ce n’est plus tout à fait une enquête. On va retrouver, tout le long du livre un peu la femme shérif qui ne va pas lâcher cette enquête, mais ce n’est pas le sujet du livre. Le sujet n’est pas qui a assassiné cette jeune femme qu’on retrouve au début du livre, mais quelle est la somme de mensonges, de compromissions qui, bout à bout, a conduit à cette mort ?
Le sujet du livre pour vous, n’est-ce pas juste raconter des histoires ?
Tout à fait !
…mais de manière exponentielle. Déjà, il s’agit un roman polyphonique en quatre parties — vous l’avez un peu évoqué — où, à l’intérieur de chacune, vous faites éclore un bourgeonnement continu d’histoires. Comme si chaque voix ne suffisait pas pour raconter toute l’histoire…
Oui, il y a quatre voix en cheville avec la grande voix du roman. Et puis, effectivement, plein de petites voix qui s’additionnent autour avec ceci de particulier que chaque partie est à la première personne. On a un personnage qui, en apparence, monologue et se rappelle un certain nombre de choses; Et ses souvenirs font intervenir d’autres personnages. Dans les petites voix, il y a des personnages qui ont très peu de temps ; d’autres qui apparaissent régulièrement. De grands absents, qui prennent beaucoup de place, et puis des présents moins charismatiques, moins engagés.
Ces voix sont quasiment des yeux. Bien que ce roman soit très américain, on a l’impression qu’il y a un panneau “Voisins-vigilants“ planté à l’entrée de Mercy ! Tout est épié par les habitants et personne n’a réellement de secrets pour les autres…
Cette petite ville où tout le monde sait ce que vous faites, avec qui, quand, comment, personnellement, c’est mon cauchemar absolu ! Il y a vraiment un effet bocal. C’est pour ça que je voulais cette jolie petite ville tranquille, sans criminalité, mais qui en réalité n’est pas nécessairement mieux qu’une autre. On regarde l’autre, on regarde qui vient de l’extérieur, qui fait quoi, on juge et on met au ban assez rapidement ; on repêche aussi parfois — mais ça c’est universel.
Il y a aussi une fausse sollicitude vis-à-vis des personnes qui ont été touchées par le malheur. On les aide parce qu’on a envie de se faire bien voir par le reste de la ville.
C’est ça : c’est une sollicitude pour se dire à soi-même qu’on a fait ce qu’il fallait. Le personnage du père de cette jeune fille assassinée a subi au moins deux grands malheurs ; après la crise des surprimes de 2008, il a perdu son garage, sa maison, sa femme part dans la foulée. Et là, la ville le laisse tomber ; il représente l’échec au pays du capitalisme. Il représente ce pays qui a chuté, l’échec du capitalisme américain et suscite du mépris.Mais par contre quand sa fille meurt, il y a une sollicitude qui arrive en décalé, dix ans plus tard, et qui répond au besoin des habitants de se sentir plein de gentillesse alors que, probablement, ils ne le sont pas.
Vous reprenez aussi une figure emblématique du cinéma hollywoodien des années 1930-40, celle de la femme fatale. Réactualisée pour Livia, mais plus traditionnelle pour une ancienne Miss Kentucky…
On ne va pas trouver de faible femme dans ce livre ! C’était quand même tentant, cette Miss Kentucky, qui a à peu près 45 ans, qui fait un peu trop d’injections. Sa volonté de rester jeune la rend un peu caricaturale mais tout à fait… crédible, je pense. Et puis il y a cette belle Italienne qui vient de l’extérieur, qu’ils n’ont jamais vue dans cette ville mais elle finit par repartir. ll y a des femmes qui se laissent un peu écraser, des femmes qui se libèrent ; un personnage de jeune fille en colère qui ne veut rentrer dans aucun moule.
Il y en a une qui affirme son autorité à beaucoup d’égards, c’est Lauren la shérif, qui ouvre le livre….
Oui, dans la première partie, qui est la plus “conventionnelle”. On ne sait pas trop si elle avait envie de devenir shérif de cette petite ville. Elle l’est devenue parce que l’ancien shérif a décidé qu’elle allait le remplacer. En plus, c’est une femme qui est tombée amoureuse d’une femme, ça fait beaucoup pour une petite ville ! Finalement, tout ça va très bien à tout le monde pourvu qu’il ne se passe rien mais on découvre un cadavre. Alors là, il y a quand même un homme pour se dire que finalement, le boulot serait mieux fait s’il s’en occupait.
Et on finit le premier quart du livre en disant que ça passerait mieux avec quelqu’un d’autre que cette enquêtrice, qui n’est personne : elle s’est contentée de s’occuper de la circulation, des problèmes de base… Sans mode d’emploi, parce que son mentor a la maladie d’Alzheimer et n’est plus en mesure de l’aider. Mais on la suit pendant ce livre et elle ne va pas lâcher malgré les résistances — les shérifs sont élus dans les petites villes américaines, pas désignés par l’administration.
Une campagne électorale se prépare d’ailleurs : des candidats se présentent contre elle, dont son adjoint soutenu par le maire… C’est un marigot assez détestable, sans compter les difficultés intimes qui peuvent aussi peser sur la vie de Lauren…
Oui, c’est assez banal. Lauren a comme particularité d’être née dans une famille de garçons, d’avoir perdu sa mère à sa naissance et de n’avoir pas du tout été consciente de ce que c’était que d’être une fille — une petite fille, puis une jeune fille avant l’arrivée des première règles. Et là , elle a compris qu’elle faisait partie d’un sexe absent de la maison, sa mère n’étant plus là, et que ça allait être une malédiction d’être une femme. En même temps, par cette mort à élucider, elle va, petit à petit, s’affirmer en shérif, mais aussi s’affirmer en tant que femme. À sa place.
J’ai compris, après Blizzard, qu’il faut quand même dans un livre mettre un peu d’espoir, sinon ça devient vraiment sinistre.
Marie Vingtras
Et devenir une des femmes puissantes — et positives — du roman.
Oui, oui, c’est quelqu’un de bien. On peut avoir un jugement ou une appréciation morale sur les autres personnages. Ils ont tous quelque chose à se faire pardonner ou à cacher. Elle, elle est plutôt intègre. J’ai compris, après Blizzard qu’il faut quand même dans un livre mettre un peu d’espoir, sinon ça devient vraiment sinistre.
La chronologie est importante dans Les Âmes féroces, qui est segmenté en personnages, mais aussi en saisons. Dès le “printemps”, connaissiez-vous l’“hiver” ?
Non. je suis partie avec un petit cadre assez léger : roman choral, Amérique, écoulement des saisons pour avoir le temps de creuser chaque personnage. Une jeune femme morte au début et je sais qui en est le responsable. Et au milieu, c’était très ouvert à tous les possibles. Mais je ne prépare pas à l’avance, ça vient vraiment au fur et à mesure.
Quid des flash-back ? Parce que de Mercy, on va aller à New York, mais aussi dans un autre “territoire” — une prison… Pas mal de lieux et d’événements vont retarder le moment de la révélation… qui n’est pas fatalement le plus important dans l’histoire.
Je suis la championne de la digression, ce qui fait que j’écris finalement de cette manière-là : Je commence une partie ou un passage — le personnage est bien là avec nous, il parle à la première personne, et hop ! on part ailleurs.
Parfois, vous commencez à lire un livre — ça m’est arrivé il n’y a pas très longtemps, c’est d’ailleurs le signe d’un très bon livre en général — et puis hop, vous passez à autre chose, vous pensez à autre chose. Ce n’est pas forcément les livres ennuyeux, au contraire, ce sont les livres qui vous projettent dans quelque chose qui se déclenche. Une réflexion, et on revient au livre, ont continue et ça fait une lecture très très longue. Mais c’est merveilleux ces livres, ces écrits sont des espèces de portes ou des fenêtres.
Revenons sur ce territoire particulier de la prison, dans lequel se retrouve projeté un personnage. Comment vous êtes-vous immergée dans cet univers carcéral précis ?
C’est un univers qui peut être très dangereux à l’écrit, parce que ça fait penser à des séries américaines. C’est une prison de comté — j’ai fait des recherches : c’est là qu’on met les auteurs de petits délits qui sont en attente de procès ; les auteurs de crimes graves sont dans les prisons d’État ou les prisons fédérales. Dans un comté calme comme celui où se situe cette ville, les prisons de comté hébergent des types qui se sont tapés dessus le samedi soir à la sortie d’un bar. C’est une prison presque rurale, tout le monde se connaît ; il y a des brutes ou des types bas du plafond potentiellement, mais ce ne sont pas de dangereux criminels.
Et là arrive effectivement au milieu un personnage qui détonne. Ça m’a plus amusée de placer dans un autre décor particulier ce personnage — ce dandy, ce type chic — qui est là par sa propre volonté, en plus.
Son avocat plein de poussière au milieu de cet univers détonne aussi…
Oui, c’est un avocat de New York, que sa mère a dépêché à toute allure, mais qui lui aussi est une anomalie dans ce décor rural de gens simples. On est à la campagne et il vient défendre un type qui s’est accusé de quelque chose d’absolument atroce.
Cette mère travaille dans le monde de l’édition. Avec, au passage un tacle au monde de l’édition — américain, évidemment. A-t-il quelque chose méritant qu’on s’intéresse à lui ?
Non. En fait, il y a eu des warnings de mon éditrice américaine : « Attention, attention, attention, le personnage de l’écrivain en littérature, c’est casse-gueule ! Parce qu’on va vous dire : “Ah, mais c’est vous, l’écrivain.” » Là, je pense qu’il est suffisamment différent pour qu’on ne me pose pas la question. La prison et l’adolescence, c’était d’autres warnings pour ne pas être caricaturale. J’ai essayé d’imaginer ces grandes famille de la bourgeoisie américaine. Le père est éditeur ; la mère est issue d’une prestigieuse famille new-yorkaise, elle ne travaille pas spécialement.
Mais plus que de me moquer du monde de l’édition, c’était d’une classe sociale américaine. Le monde de l’édition américaine est très particulier, ce n’est pas le même fonctionnement qu’en France : on va verser des avances pharaoniques aux auteurs. Mais s’ils ne vendent pas, ils remboursent les avances. Si le premier livre ne marche pas, il n’y aura pas de deuxième livre. C’est vraiment un autre fonctionnement que l’édition à la française.
Vous parlez des warnings liés à l’adolescence. De quelle nature étaient-ils ?
L’avertissement était plutôt sur le ton du troisième personnage s’exprimant à la première personne. Une adolescente de 17 ans — ce que je ne suis plus. Forcément, il ne faut pas tomber dans un langage familier. C’est une adolescente américaine, pas française. C’est la partie qu’on a le plus retravaillée pour essayer d’avoir un ton… J’avais rencontré beaucoup de lycéens pour Blizzard, ce n’est pas encore le cas donc je ne sais pas si ce ton est crédible pour eux. C’est compliqué de trouver ce juste milieu.
Elle n’est pas encore adulte bien qu’elle soit arrivée brutalement dans cet univers par quelque chose qu’elle n’aurait pas dû entendre. Mais elle n’est plus une enfant non plus. C’est le moment charnière qu’on s’empresse tous d’oublier une fois qu’on a le bac, qu’on commence nos études. Tout ce qu’on veut laisser derrière nous, c’est ces périodes d’adolescence, qui sont quand même souvent mouvementées.
Vous évoquez cette question de trouver ce point juste. On a ici un roman à quatre voix. Quatre tons, quatre tonalités, quatre écritures différentes. En plus d’avoir voulu leur donner leur propre voix, avez-vous cherché à ce que votre écriture soit comme empreinte d’une prosodie américaine ?
Quand j’ai quitté le lycée, je n’avais étudié que des auteurs hommes, français, morts. Tous. Je ne pouvais pas me projeter dans l’écriture avec Victor Hugo, Balzac, Maupassant. Je voulais raconter des histoires mais sans avoir à réfléchir à tout ce qu’il y avait autour du style, la beauté de la phrase, des figures de style, des répétitions, des métaphores… Je ne peux pas réfléchir en écrivant, ce n’est pas possible ! Donc, j’ai basculé vers une littérature étrangère, notamment américaine, mais pas qu’américaine.
Et dans la littérature étrangère, j’ai trouvé une autre manière d’écrire. Donc, peut-être que ce que ça a d’américain dans la manière d’écrire, c’est cette façon de raconter les histoires sans forcément avoir un dialogue à la ligne conventionnel. Ce n’est pas que les auteurs français maintenant soient tous conventionnels, ils font des choses très audacieuses, mais l’image que j’en avais à la sortie du lycée, était tellement codifiée…
On peut donc trouver une liberté absolue par la typographie…
Dans le dernier livre de Joyce Carol Oates, les parties en italiques correspondent aux pensées de son personnages. Le summum, c’est Ken Kesey, qui a écrit Vol au-dessus d’un nid de coucou, et a aussi écrit Et quelque fois j’ai comme une grande idée. Je ne vais pas vous mentir : les soixante-dix premières pages on se dit « Wow ! » Il faut vraiment être tout seul, que personne ne vous parle, ne pas être dans le tramway ni dans le métro, mais à la maison, tranquille. À un moment donné, j’ai tilté que sur les pages, il y avait une police normale, puis des phrases en majuscule, puis des phrases entre parenthèses, puis des phrases en italiques.
En fait, il y avait quatre personnages qui parlaient. C’est un livre extraordinaire. Il est vraiment dans le top 5 des livres qui m’ont le plus bouleversée. Voilà de l’audace, voilà un risque vis-à-vis du lecteur. Parce que le lecteur, il est comme tout le monde. Il faut qu’il ait la patience de passer 50 pages — et après encore, ça continue à être compliqué.
Lorsque vous avez trouvé la manière dont vous alliez raconter ce récit, l’avez-vous soumise à votre éditrice ?
Je lui ai donné la première partie tout bonnement pour des histoires prosaïques de « il faut conclure le contrat pour le prochain » et puis convenir d’une date pour le rendre. Donc, c’est un peu, théoriquement, pour rouvrir l’appétit de l’éditeur : « je travaille là-dessus, est-ce que ça t’intéresse, est-ce qu’on fait quelque chose ? « Après, elle a eu le résultat complètement à la fin, c’est un pari que l’éditeur prend. Il y avait déjà eu un livre avant, elle voyait à peu près où elle allait

Y a-t-il une frustration d’arriver à la fin, et à ce dénouement, même si vous l’aviez anticipé ?
Non. Pendant des années, j’ai écrit sur l’ordinateur des tas de livres que je n’ai jamais terminés Parce que l’ordinateur ne me convient pas. Mon premier jet, c’est pas du tout ce qu’il me faut. Des livres pas finis, j’en ai bien plus que je ne reprendrai pas, c’est terminé. Donc, la première fois que j’ai réussi à finir d’écrire un livre, à la main, j’ai continué la méthode qui a l’air de fonctionner.
Et une fois que l’histoire est finie, je suis toute fière de moi, mais vraiment, fière de moi comme un enfant à la maternelle quand il fait le cadeau de la fête des mères. Je regarde mon objet, je regarde ma pile de cahiers, je dis : « ah, tu l’as fait, bravo, on va reprendre l’ordinateur maintenant » Je suis toujours contente de finir. Et je fais inconsciemment ce que d’autres auteurs font : dès qu’il est fini, il faut commencer autre chose — pas forcément très avancé —, ne serait-ce que, d’ailleurs, si le livre ne marche pas, pour se dire : « c’est pas très grave, j’ai une solution de repli ».
La question découle surtout du fait qu’il y a énormément de personnages dans Les Âmes féroces vivant avec des frustrations, des attentes, des rêves à chaque fois entravés…
Ah moi je n’en suis pas passé loin ! (sourire) À neuf ans, j’écrivais, je regardais Apostrophes avec mes parents. Mes amis me disent : « mais tout le monde regardait Apostrophes, même mes enfants, il n’y a rien d’anormal ! » Moi, quand même, je partais me coucher en imaginant Bernard Pivot m’invitant, me disant que j’avais écrit un livre d’une grande maturité, fantastique ! J’ai fait une une crise de déprime quand il est mort, en me disant : « je ne serai jamais interviewée par Bernard Pivot » Bref, entre ces 9 ans et la sorties de Blizzard à 49, il s’est écoulé 40 ans — je sais, je n’ai pas été d’une rapidité folle. Mais effectivement, si je n’avais pas écrit, j’aurais été comme mes personnages : en frustration ou en manque.
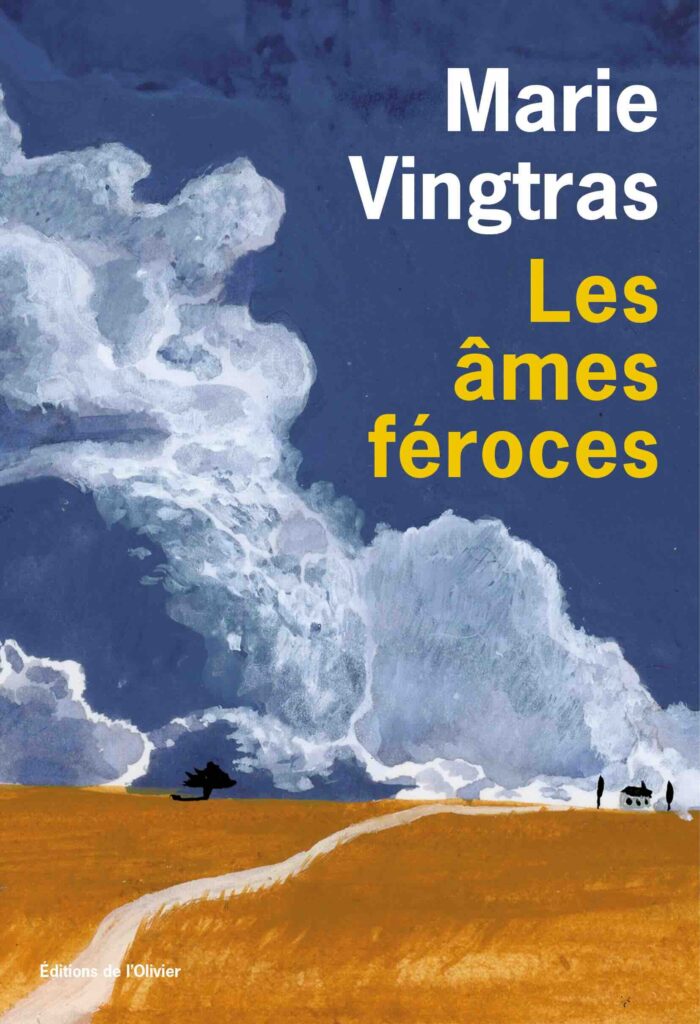
Les Âmes féroces de Marie Vingtras, L’Olivier, 272 p. (5h de lecture)
Marie Vingtras à Quais du Polar :
Vendredi 5 avril à 10h à la 🔗 Chapelle de la Trinité dans le cadre de 🔗 Une autre conquête de l’Ouest : ces romans américains écrits par des francophones
Vendredi 5 avril à| 15h30 à l’🔗 Hôtel de Ville – Grand Salon dans le cadre de 🔗 Girl power : inverser les codes et débrancher l’emprise mâle
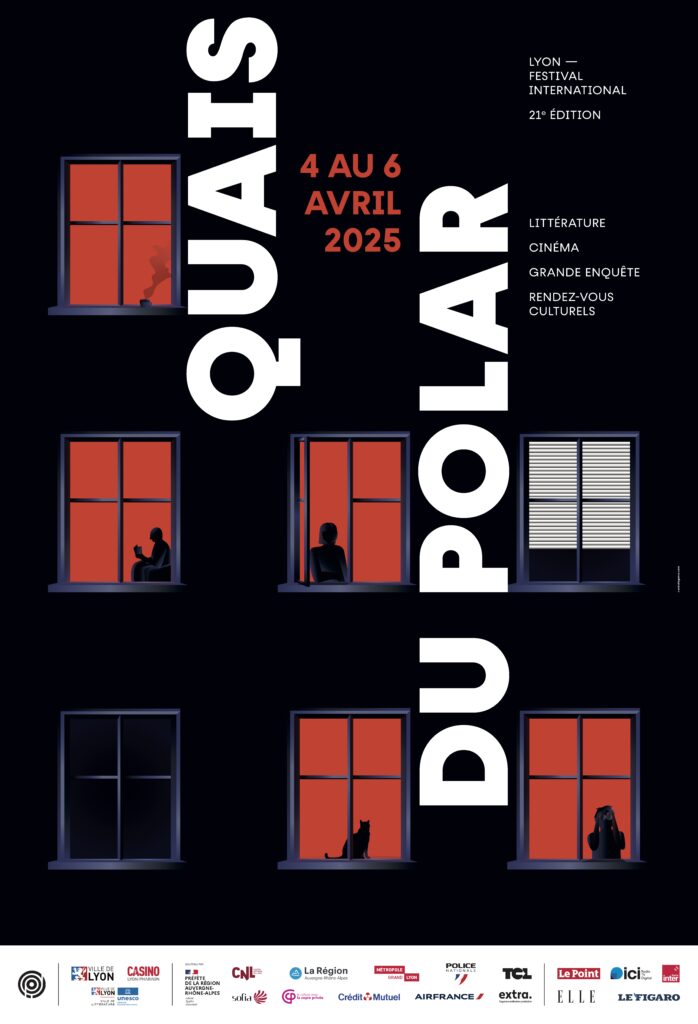
Vendredi 5 avril 2025 à 17h45 à l’🔗 Institut Lumière pour présenter De beaux lendemains.
- Stimento est média associé à Quais du Polar ↩︎