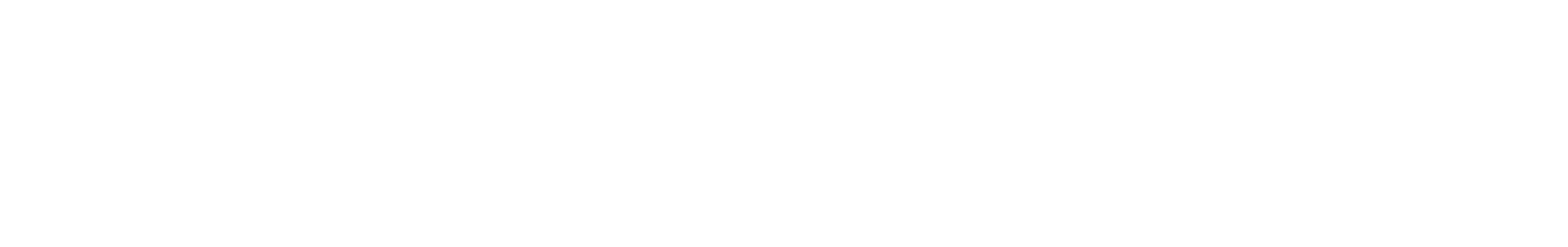Histoire d’une renaissance multiple dans la Tunisie d’aujourd’hui, “Aïcha” emprunte aux faits divers pour aller au-delà du réel. Un portrait de femme saisissant signé par Mehdi M. Barsaoui, rencontré au Festival de Sarlat.
Avez-vous hésité longtemps pour le choix du titre ?
Mehdi M. Barsaoui : Pas du tout. C’est un choix qui s’est imposé dès le départ parce que Aïcha en arabe veut dire “vivante” ; c’est aussi un prénom. Ça s’est imposé alors que le film était encore au stade embryonnaire.
Il prend sens dans les dernières secondes…
Absolument D’ailleurs, quand on montrait le film au début, les gens étaient intrigués parce qu’ils étaient certains que le personnage principal allait porter le nom d’Aïcha. L’idée, c’est comment devenir Aïcha. Tous ces périples font que le titre révèle tout son sens à la fin.
Si l’on s’en tient à la traduction que vous donniez, c’est presque « comment devenir vivant » ?
Comment vivre, déjà et… oui, vous avez raison c’est plus comment “devenir vivant” que comment vivre parce que elle est vivante mais — je n‘aime pas le terme — c’est une morte-vivante. Elle est éteinte, à l’image de toute une génération en Tunisie, qui est un peu la mienne aussi. Dans le sens où on sait qu’en 2011 avec la révolution — je n’aime pas du tout le terme “printemps arabe”, encore moins “printemps du jasmin“ —, on a inspiré des rêves. Et malheureusement, on a vite déchanté. 2015 a été une année terrible pour vous mais aussi pour nous en Tunisie : on a on a essuyé pas mal d’attentats terroristes de Daesh. On s’est éteint petit à petit ; après est venue la crise financière, la crise du Covid… Bref ça raconte des espoirs brisés de toute une génération qui aspire, finalement, à vivre. Ça raconte le destin de cette femme qui en a marre de survivre et qui veut seulement vivre.
Vous évoquez en filigrane une histoire de morts qui ne sont pas déclarés à l’état civil. Est-elle bien réelle ?
Ça c’est un scandale qui a éclaté en 2011, à la suite des premières élections post-Ben Ali. En 2011, quand le parti islamiste a remporté haut la main les élections, on s’est rendu compte qu’il y avait énormément de morts qui avaient voté. : ils étaient encore déclarés vivants au sein du ministère de l’Intérieur alors qu’ils étaient effectivement morts.Du coup, [le film] vient dénoncer le système en Tunisie où les mises à jour ne sont pas automatiquement faites. Chaque système doit apporter des mises à jour tout seul. Quand une personne est déclarée morte à l’état civil, il n’y a pas un numéro d’identifiant unique qui fait que tout s’imbrique derrière : il faut alerter tous les services. Je trouvais ce scandale symptomatique de ce qu’on vit : tout est laissé à l’abandon ; c’est dans ces petites brèches qu’on peut s’incruster.
Aïcha est-il le parcours d’une transformation ou d’une émancipation ?
C’est les deux. Elle ne peut s’émanciper qu’en se transformant. Mais pour être franc, je préfère le terme d’affranchissement à émancipation. Je trouve le terme émancipation moins complexe qu’affranchissement. Elle s’affranchit de tout ce qui pesait sur ses épaules. Elle se libère de la pression familiale, professionnelle, religieuse ; du regard des autres… Elle s’affranchit de tout ça. Alors que quand on s’émancipe, c’est par rapport à sa condition dans la société. Là, c’est beaucoup plus : elle s’affranchit de tout ce qui l’emprisonne.
Était-ce l’idéal de la révolution ?
Absolument. C’est ce à quoi on aspirait : être complètement libre. Après, la définition d’être libre est très ample. Mais le fait de pouvoir vivre la vie qu’on souhaite, en tant que femme ou homme — Fares le policier s’affranchit de sa culpabilité. En fin de compte, c’est aussi un film sur la culpabilité, sur l’injustice.
Il y a aussi un affranchissement du patriarcat Mais ce qui est assez paradoxal, c’est que les deux figures les plus pesantes du patriarcat sont la mère et Lobna, la colocataire d’Aya…
Alors, pour la mère, je suis parfaitement d’accord : c’est le patriarcat, mais aussi le matriarcat. Ce qui est drôle avec la société tunisienne, c’est qu’elle est très patriarcale en façade et dans ses mœurs. Mais au sein des foyers, elle est très matriarcale : la femme décide de tout. Malheureusement, ce n’est pas appliqué en dehors du foyer. Pour la mère, c’est effectivement le cas. Mais c’était délibéré de raconter ce schéma : je voulais casser les codes parce que le père est très effacé. Très éteint, brisé à l’intérieur de lui-même, parce que ses rêves ont été brisés. C’est un homme qui ne fait que survivre. Et c’est ce à quoi Aya était destinée en restant à Tozeur ; comme sa mère qui ne vit pas, qui n’arrive pas à boucler ses fins de mois. Elle est toujours en retard.. En décidant de “mourir”, elle décide de tuer tout ce qu’elle ne veut pas être.

Là où je ne suis pas d’accord avec vous, c’est comment le patriarcat s’exerce et comment il s’applique sur sa colocataire Lobna. Elle ne fait que perpétuer l’idée du pouvoir masculin mais elle en est consciente et elle l’a décidé. Est-ce que ça en fait d’elle quelqu’un de soumis ? Je ne sais pas. En tous les cas, moi, en tant qu’auteur, en écrivant de scénario, pour moi, Lobna est libre parce qu’elle a décidé de se faire entretenir. Personne ne l’a décidé pour elle. On peut ne pas partager, mais c’était important pour moi de ne pas la juger en tant qu’auteur. Et je ne voulais pas qu’on la juge parce que c’est un personnage négatif. Au contraire, qu’on essaye de la comprendre. Finalement, c’est un personnage que j’aime beaucoup parce qu’elle est prisonnière de ses aspirations : elle rêve à un truc qu’elle ne peut pas s’offrir et malheureusement, elle est encore à ce stade où il faut qu’elle se fasse entretenir pour arriver à avoir ce dont elle a rêvé.
Justement, elle est en train de finir son doctorat. Peut-être que si on reprend le film dans 5 ans, peut-être qu’elle se sera complètement affranchie, elle aussi, du pouvoir masculin dont elle a besoin pour finalement avoir ce dont elle rêve ? Tout ce truc pour dire que c’est un petit peu plus complexe. Mais après, le patriarcat, je pense, il s’exerce et il s’applique surtout sur Rafik, l’antagoniste. Et sur l’impunité de la police et l’impunité des personnes qui ont du pouvoir.
Le père est aussi une figure complexe, malgré sa discrétion…
Le père apprend une énorme leçon de vie à travers sa fille, justement, dans un pays et une culture qui sacralisent la figure paternelle — mais même maternelle. Dans la culture musulmane, il y a un verset du Coran dont la traduction sommaire est : « il n’y aura aucune bénédiction divine sans la bénédiction des parents » , la plus grande crainte, c’est que les parents meurent et que les enfants soient en désaccord. Dans un pays qui sacralise la figure parentale, oser se confronter de cette manière à ses parents est un énorme acte de modernité. Et le fait qu’elle leur disent non, c’est là qu’elle décide de se tuer véritablement,
Au début du film, tout est imposé à Aya par sa mère, par son amant, par sa boss. Même l’accident lui est imposé. Par contre, à la fin, après la confrontation avec son père, quand il vient lui demander des excuses, c’est elle qui décide de mourir. Et elle leur dit, « la Aya que vous avez connue est morte ». C’est là qu’elle décide véritablement de tuer Aya et devenir la personne qu’elle a toujours essayé de vouloir être. Le père ne dit rien tout au long du film et la seule fois où il parle, on ne l’entend pas. Et effectivement, elle le réveille de sa torpeur, il sort de son côté anesthésié. Elle lui insuffle de nouveau la vie.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de parler d’une femme ?
C’est un choix qui s’est imposé. D’abord le fait divers d’origine, c’est une femme. Mais tout est né un soir durant la promotion d’Un fils, mon premier film, où entre deux voyages, j’étais rentré à la Tunis faire coucou à ma mère. Elle était en train de regarder la télé de la nuit, et je vois une espèce d’émission où on invite des gens à qui on voudrait demander pardon derrière un rideau.
Une fille était là et elle avait invité ses parents pour leur demander pardon pour ce qu’elle leur avait infligé : elle avait survécu à un accident et elle avait demandé à sa meilleure amie d’appeler ses parents pour leur dire qu’elle était morte. Elle voulait voir comment ils allaient réagir. J’avais trouvé cet acte à la fois désespérant et courageux, héroïque même. Mais à cette époque, j’avais regardé le fait d’hiver, sans avoir encore conscience que j’allais en faire un film… jusqu’à ce que des mois plus tard, ma femme et moi, on apprenne qu’on allait avoir une fille.
Là, je sais pas ce qui s’est passé — je pense que c’est l’angoisse de l’inconnu, de devenir père pour la première fois — je me suis tout de suite projeté : et si ma fille, un jour, m’infligeait ce que cette fille a infligé à ses parents ? C’est comme ça que cette idée a commencé à se faire en moi, et ne m’a plus quitté. J’ai décidé que je voulais en faire un film. Je me suis complètement écarté du fait divers parce que retranscrire ce simple fait divers ne m’intéressait pas. Surtout, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que la fille était psychologiquement instable et je trouvais ça complètement inintéressant, trop primaire, trop basique et du coup, trop simple. Je ne voulais pas du tout la condamner. Je me suis décidé à m’inspirer du fait d’origine pour raconter autre chose et à inventer un nouveau personnage : le film est très très loin du fait divers d’origine.
Pensez-vous qu’il y a une mutation dans le cinéma contemporain algérien, tunisien, marocain en particulier en ce qui concerne la place des femmes ?
Je pense qu’il y a un véritable renouveau dans le cinéma arabe, plus maghrébin, depuis 2011 et depuis ce qui s’est passé. Avant 2011, le cinéma était complètement déconnecté du peuple et de la réalité sociale : on était en dictature ; il fallait utiliser des métaphores pour oser dénoncer, mais ce n’était jamais direct. Même les spectateurs avaient complètement déserté les salles de cinéma parce que c’était un cinéma qui ne les présentaient pas. Depuis qu’on s’est libéré de cette dictature, ce cinéma devient de plus en plus social, proche de thématiques sociales qui représentent le commun des mortels et le Tunisien moyen, l’Algérien moyen… Au Maroc, c’est plus compliqué. Je ne suis pas marocain, je ne suis pas un spécialiste, je ne veux pas généraliser, mais le Maroc est spécial parce que c’est un royaume et ils n’ont pas vécu de révolution…
Pour le reste des pays du Maghreb, il y a eu cet affranchissement et cette émancipation, justement dans des thématiques plus sociales et dans des personnages plus ordinaires. Quand on voit La Belle et la Meute, Les Ordinaires de Mohamed Ben Attia, Ashkal… C’est des personnages qui ressemblent à Monsieur Tout-le-monde. Et du coup, il y a une nouvelle connexion entre le cinéma et le peuple. Naît une nouvelle dynamique très représentative des problèmes qu’on vit en Tunisie. Si on prend l’exemple de Aïcha, c’est une thématique qui pourrait même être universelle : quelqu’un qui vient d’un village reculé qui part vers la ville… Des millions de Français, d’Européens, de Sénégalais ou d’Australiens vivent ce déracinement ; c’est des thématiques nouvelles dans le cinéma maghrébin, mais qui deviennent de plus en plus représentatives.
Avec un personnage féminin…
Il y a de plus en plus de personnages féminins, mais pour être franc, je ne sais pas si c’est lié au post 2011. Ce que je sais et je trouve ça super en tant qu’homme et auteur, en aucun cas ne me suis autocensuré ou remis en question en osant raconter une histoire de femme. Je pense être légitime parce qu’au-delà du genre, c’est un être humain. Si on doit être une femme pour raconter le destin d’une femme… Quand j’ai fait Un fils, je n’étais pas encore père. Je pense qu’il faut se garder cette liberté. Tant qu’on est régi par des émotions, je pense qu’on peut tout raconter.
Tout ça pour dire que je ne sais pas s’il y a eu une véritable libération ou il y a eu un véritable changement. Parce que j’essaie de me remémorer des films avant 2011, avec des personnages féminins. Après, le cinéma tunisien avant 2011, ce n’était pas terrible… On a vécu un âge d’or dans les années 1990 avec des films qui ont quand même marqué l’histoire du cinéma tunisien, comme Les Silences du Palais, d’une réalisatrice femme, Mufida Tatli, qui nous a quittés il y a deux ans, je crois. Et qui était portée par deux sublimes personnages féminins. Mais c’est super que les femmes occupent de plus en plus l’écran !

Aïcha de Mehdi M. Barsaoui avec (Tu.-Fr.-It., 2h03) avec Fatma Sfar, Yasmine Dimassi, Nidhal Saadi, Hela Ayed, Mohamed Ali Ben Jemaa, Ala Benhamad, Sawssen Maalej… En salle le 19 mars 2025.