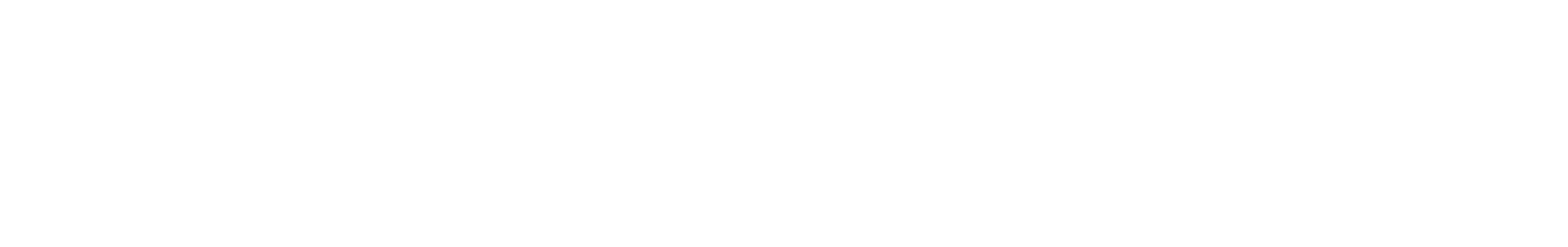Thriller scientifique pouvant à tout moment se transformer en film d’anticipation, Magma rappelle la fragilité du savoir scientifique et l’orgueil absurde du pouvoir politique face aux incertitudes de la nature. Conversation avec le réalisateur à l’occasion du Festival de Sarlat.
Aviez-vous un lien particulier aux volcans avant le film ?
Cyprien Vial : Je ne suis pas un grand sportif, mais depuis que je suis petit, j’aime bien la randonnée et la montagne. Et j’ai développé un lien aux volcans assez fort au cours des 15 dernières années. J’aime particulièrement me promener sur les volcans, parce que ce sont des montagnes qui racontent des histoires. Le volcan nous raconte sa vie via des couleurs, des formes des roches. Ça me plaît parce que j’aime la montagne et qu’on me raconte des histoires. J’aime bien me sentir très petit et peut-être très inutile, sur ces montagnes en particulier, qui me calment. Peut-être parce qu’elles sont dangereuses et que quand je grimpe au-dessus, la situation n’est pas dangereuse.
Il y a un souvenir de début d’adolescence lié aux volcans peut-être à l’origine de ce film. Quand j’avais 13 ans, je suis parti avec mes parents en Guadeloupe et on est monté à la Soufrière. Ça a été une expérience très… grisante et étonnante, parce qu’en fait, je n’ai pas eu de prise visuelle avec cette montagne. Chaque jour, on avait envie de monter mais la météo n’était pas bonne. On a fini par monter avec une météo très mauvaise. Et j’ai eu la sensation vraiment d’entrer dans une sorte de monde parallèle, gris, avec un mélange de nuages et de volutes de soufre. Et de perdre complètement mes repères. À un moment, je ne voyais plus ma famille et ça m’a procuré une sorte d’exaltation étrange ; un mélange de peur et d’excitation. C’est ce que je recherche en faisant des films.
Quand j’étais petit, on déménageait tous les deux ans à peu près avec mes parents, pour le métier de mon père. Je crois que ces déménagements m’ont habitué à aller voir ailleurs de façon régulière et ont développé une sorte d’addiction à la découverte d’autres territoires. Le cinéma pour moi est un moyen de me déplacer, d’aller voir ailleurs peut-être si j’y suis. Ce film en particulier s’inscrit dans cette dynamique-là : de me confronter à un territoire que je ne connais pas, où j’ai ressenti quelque chose d’assez bizarre. Et où j’ai envie tout d’un coup de retourner.

Votre ressenti d’une frustration à La Soufrière n’est pas sans évoquer le sentiment éprouvé par l’un de vos glorieux aînés, Werner Herzog dans son film La Soufrière (1976). Vous retransmettez ce même sentiment ici avec une catastrophe qui n’arrive pas…
C’est marrant parce que La Soufrière, c’est un film que, évidemment, j’aime beaucoup ; mon intérêt pour les volcans m’avait permis de le voir. Je l’ai revu pendant le confinement : ces images m’ont rappelé mon séjour d’enfance sur le volcan : les rues vides de Basse-Terre — la ville évacuée massivement en 1976 parce que le volcan est en train de se réveiller et que l’on dit que c’est très dangereux.
C’est à la fois comparable et pas du tout : les rues sont aussi vides que les nôtres, les gens ne sont pas confinés, mais finalement, ils sont déplacés et ils vivent en 1976 enfermés chez leurs cousins, leurs amis, ou dans des gymnases… Donc il y a des similitudes très fortes, et surtout, une similitude thématique quotidienne de l’information scientifique confrontée à la décision politique. Donc une friction que je trouve étonnamment cousine à ce qu’on vit ; c’est à ce moment-là que j’ai très envie de comprendre ce qui s’est passé en 1976 et peut-être d’en faire une revisite : qu’est-ce qui se passerait aujourd’hui si le volcan se réveillait à nouveau comme en 1976 ?
Après, la matrice émotionnelle du film d’Herzog — c’est-à-dire la frustration, la tension sourde qui habite son film — est l’émotion première que j’ai cherchée plus ou moins consciemment à travailler. On a essayé d’écrire un film qui mette le spectateur dans une situation d’inconfort et d’intranquillité très forte, dans un état où il ne sait pas trop qui du volcan, de Katia ou de la population va péter un plomb en premier. C’est cette incertitude et ce sentiment d’inconfort qui, moi, m’intéressent plus que l’explosion de lave qu’on a l’habitude de voir dans les blockbusters volcaniques.
Comment avez-vous travaillé avec votre coscénariste Nicolas Pleskof ?
C’est assez ludique parce que ni Nicolas ni moi n’a jamais eu avant à travailler une matière loin de nos connaissances. Comment rendre une histoire scientifique un peu technique, compliquée, à peu près digeste, tout en employant des mots que les gens ne comprendront pas — et ce n’est pas grave ?
Le fait qu’un des protagonistes soit un jeune scientifique peut aider…
Oui, parfois, ça aide effectivement qu’il connaisse moins ; ça permet de comprendre mieux… Ce film m’a permis de devenir un peu apprenti géologue. Et parce que faire un film donne envie de se déplacer, d’apprendre des choses, j’ai eu envie que le film puisse évoquer une situation crédible. Donc la narration scientifique, cette histoire de lahar, c’est une manière pour moi aussi de raconter le volcan en tant qu’être vivant compliqué, qui n’est pas juste un cracheur de lave, mais peut-être aussi un vomisseur de boue — ou aussi un cracheur de cailloux, de fumée… D’ailleurs, au début, je demandais à mes deux conseillères volcanologues, spécialistes des volcans des Antilles : « Alors, la Soufrière, il est dans quelle catégorie ? ». Et elles rigolaient : « Tu sais, les volcans, c’est des créatures non-binaires. Peut-être que la Soufrière est un volcan gris aujourd’hui, mais à l’échelle de sa vie, il peut tout à fait changer de genre, de catégorie et devenir rouge »
Vous avez porté une grande attention au réalisme et à la crédibilité. Pour autant, est-il réaliste qu’une patronne de labo puisse se remettre en cause quand sonpool pointe le fait qu’elle parte à la dérive et soit dans une bulle sensorielle ?
Je voulais le montrer parce qu’il m’a semblé l’avoir aperçu chez des scientifiques qu’on voyait tout le temps à la télévision pendant l’ère Covid. J’ai l’impression que cette position des scientifiques dont on attend qu’ils détiennent une vérité chaque jour renouvelée — adaptée à ce que la sphère politique et la sphère sociétale espèrent — est hyper difficile à tenir. Encore plus dans un métier comme celui de volcanologue où les crises sont quand même assez rares.

L’un des éléments qui m’amusent dans le film, c’est de raconter un récit d’apprentissage d’une femme de 52 ans. Elle n’a jamais vécu ça et donc il me semble réaliste qu’elle puisse vriller à un moment. Après, c’est un film de fiction… Sur cette même ligne un peu ténue de véracité, est-il crédible que le jeune homme parte vraiment sur le terrain alors que c’est extrêmement dangereux et qu’il y arrive ? J’ai envie de croire que c’est possible.
Mon projet, ça a été d’essayer de raconter comment un binôme, aujourd’hui, dans une situation cousine de celle de 1976 tout en vivant quelque chose de très tendu et d’intranquille, pouvait peut-être fabriquer quelque chose de plus beau, de plus enthousiasmant. Contrairement à ce qui s’est passé en 1976, mon envie a été de créer un personnage de jeune scientifique guadeloupéen qui appartient à cette terre et qui, lui, peut-être, pourra être entendu à la fin du film. Il y a un côté un peu très naïf quand il parle face caméra mais c’était important pour moi que ça ne puisse se résoudre que par lui. Parce que la population, après ce qui s’est passé pendant le film, n’est plus prête à écouter une femme blanche sachante, malgré ses talents.
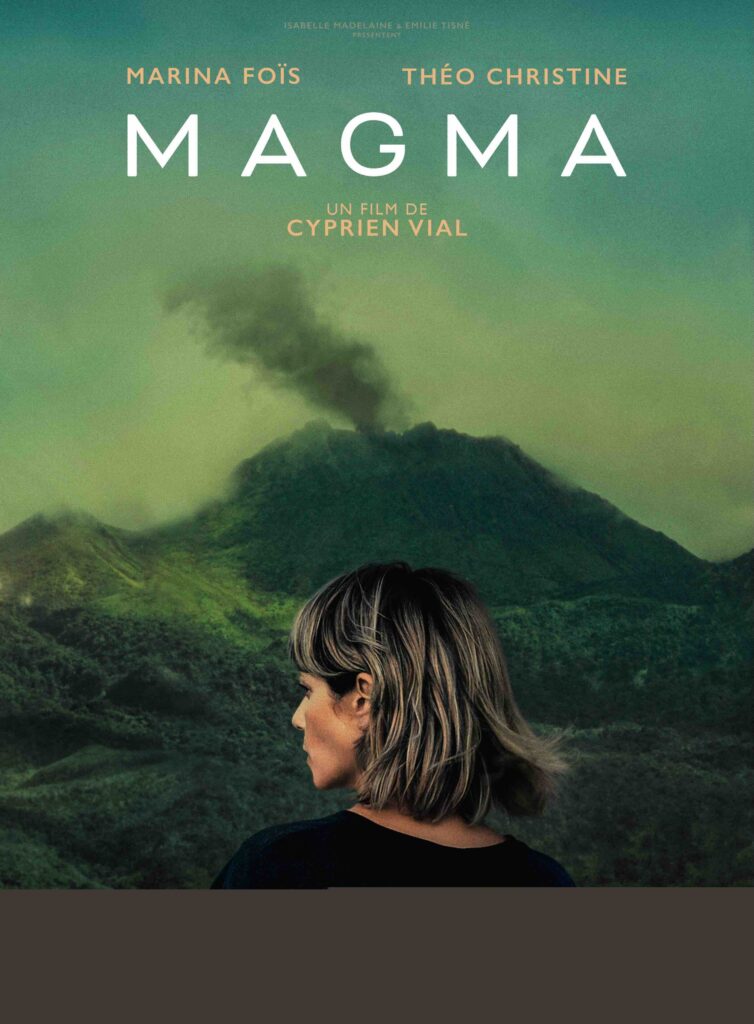
Magma de Cyprien Vial (Fr., 1h25) avec Marina Foïs, Théo Christine, Mathieu Demy… En salle le 19 mars 2025.