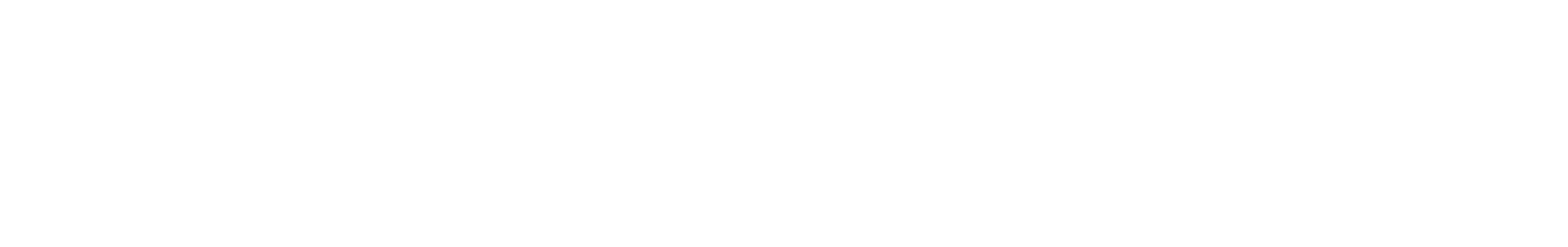Le réalisateur suisse Tim Fehlbaum signe avec 5 Septembre une époustouflante évocation de la prise d’otages des athlètes israéliens lors des J.O. de Munich en 1972 entièrement considérée du point de vue de l’équipe de télévision américaine chargée de retransmettre l’événement sportif. Un parti-pris conforme à la réalité des faits… et qui révèle en coulisses l’existence d’un autre événement historique. Conversation avec le cinéaste.
À la fois thriller et historique, votre film est irréductible à un genre. Mais n’est-il pas avant tout un film miroir ? Dans la mesure où vous racontez une histoire du passé qui nous renvoie au contemporain ; où vous montrez que du côté des journalistes, il y a des situations de négociations parallèles à celles se déroulant entre la police et les terroristes ?
Tim Fehlbaum : C’est une très belle interprétation, merci beaucoup. Ce n’était pas volontaire, mais j’aime beaucoup l’analyse que vous en faites. On pourrait même rajouter que les écrans eux-mêmes sont des miroirs. Donc, oui, j’aime l’idée : c’était quand même un film qu’on a fait sur les images, mais pas forcément au départ de façon intentionnelle sur le miroir. (Un temps) En fait, maintenant que j’y repense, l’image qui ouvre le film après la séquence introductive, c’est celle du reflet d’une télévision dans le miroir d’une table d’hôtel…
Si je parle de miroir, c’est aussi que le film nous renvoie à ces événements très contemporains que vous avez évoqués avec le public lors de l’avant-première parisienne — cet « éléphant dans la pièce », comme vous le disiez. Redoutez-vous que le calendrier géopolitique international fasse obstacle à la réception de votre film, et surtout à la bonne compréhension de tous les messages qu’il véhicule ?
Je pense que tout film historique, comme tout film futuriste, est là pour nous informer sur le présent. Et j’ai bien conscience que les événements actuels auront une influence sur le visionnage par les spectateurs. Mais je voudrais aussi que les gens sachent que c’est un film sur cet événement en particulier et sur le point de bascule qu’il a représenté dans l’histoire médiatique. L’idée, en fait, c’est de braquer les projecteurs sur notre environnement médiatique complexe et permettre au public de se questionner ensuite sur la façon dont nous recevons et dont nous consommons les médias.

Et sur la manière aussi dont les journalistes font leur métier. Puisque c’est aussi une leçon de journalisme… et une leçon pour les journalistes. Considérez votre film comme une mise en garde à leur intention ?
Oui, c’est vrai. Il faut garder en tête que ces journalistes à Munich étaient des journalistes sportifs, qui n’avaient jamais été confrontés à une telle crise politique ni à cette façon de faire de l’information. D’une certaine manière, on voit des journalistes dans une sorte d’innocence vis-à-vis de certaines questions morales parce que ce sont des questions qu’ils n’ont jamais eu à se poser quand ils étaient sur une épreuve de natation, évidemment. Et les montrer dans ce contre-la-montre, prouve aussi qu’il n’y a pas de réponse facile. En fait, les journalistes qui ont vu le film et avec qui j’ai discuté, disent que ce sont les mêmes questions qui se posent encore aujourd’hui au quotidien pour eux.
Vous avez effectué vos études à Munich, à la Hochschule für Film und Television. Vos condisciples allemands avaient-ils une conscience encore très forte de ces événements-là ?
(Un temps) Oui, j’ai vécu longtemps à Munich. Cette tragédie est toujours très présente après tous ces années. Et encore davantage il y a deux ans, à l’occasion des commémorations du cinquantième anniversaire de la tragédie. D’ailleurs, il faut savoir qu’il y a toujours à l’heure actuelle une commission spéciale qui enquête sur la façon dont les événements se sont déroulés.
Cela a-t-il été plus facile de faire le film pour vous parce que vous aviez une distance en tant que citoyen suisse ?
C’est une question intéressante. L’un de mes co-scénaristes, Moritz Binder, est allemand — et même munichois. Ses parents eux-mêmes sont munichois, ils faisaient partie de cette génération qui voulait se libérer du poids de la guerre. Lui a sans doute un ressenti, un point de vue, proche de l’état d’esprit de ses parents, différent de celui que je peux avoir avec mon recul de Suisse.
Le film est entièrement tourné en studio, donc on aurait pu le tourner n’importe où, mais je pense que ce qui a vraiment fait une différence, c’est le fait qu’on ait tourné à Munich. Parce que les acteurs, par exemple, pouvaient se rendre sur place sur les lieux des événements. En plus on a tourné certaines scènes autour du village olympique. Ça se ressent, je pense, dans le film.
Et puis, j’y pense maintenant, peut-être davantage que ma nationalité, il y a quelque chose qui a eu le plus d’effet sur moi. Durant mes années d’étudiant, j’ai beaucoup travaillé en tant que cadreur sur des documentaires ; cela m’a sans doute plus influencé dans la façon dont je me suis senti relié à ce sujet et à ce point de vue d’observateur.

C’est une parfaite transition, puisqu’il y a dans votre film des points d’écho avec le cinéma de Paul Greengrass — en particulier Bloody Sunday (dans l’image, l’approche et la tension continue) — mais aussi avec Good Night and Good Luck de George Clooney dans la mesure où vous montrez comment la télévision est partie-prenante d’un événement historique. Ces films ont-il eu une incidence sur votre travail ?
Oui, surtout Bloody Sunday. J’adore, le travail de Paul Greengrass et Bloody Sunday est un de mes films préférés. Je voudrais peut-être mentionner un autre film de Paul Greengrass qui a été une inspiration directe pour nous ici, c’est United 93 – Vol 93. Aussi parce qu’il est tourné du point de vue des contrôleurs aériens, dans un style très documentaire. Donc oui, c’est une grande inspiration. Good Night and Good Luck, bien sûr, est aussi un film génial. Nous avons également été inspirés par des films paranoïaques des années 1970, comme par exemple Conversation secrète.

5 septembre (September 5) de Tim Fehlbaum (All.-É.-U., 1h35) avec Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin, Leonie Benesch… En salle le 5 février 2025