Amphitryon des ondes, François-Régis Gaudry contribue depuis quelques lustres à l’essor de la gastronomie en mettant en valeur les produits, les créateurs et les métissages gustatifs. Dans son nouvel ouvrage Recettes & Récits, voici qu’il accommode les mets et les mots de sa vie pour nous les donner en partage. Conversation gourmande avec un généreux passeur…
Votre nouvel opus tranche avec ceux que vous avez signés auparavant — même si l’on reconnaît votre patte. Et qu’il contient plus de 150 recettes…
François-Régis Gaudry : Il est assez différent de la collection d’On va déguster, qui étaient des ouvrages collectifs, où beaucoup de contributeurs m’accompagnaient. On est sur un exercice plus personnel. Peut-être que ça a un peu perturbé certaines personnes qui me suivent. Parce qu’ils attendaient la prochaine destination d’On va déguster. Là, j’ai eu envie de me livrer à un exercice plus intimiste, plus personnel. C’est-à-dire une espèce de bilan culinaire à quelques mois de mes 50 ans, peut-être…
Au-delà, il y a une approche quasiment proustienne, même s’il n’y a pas madeleine. Vous avez justement titré ce recueil Recettes & récits, car c’est presque une autobiographie. À la différence de Proust, vous ne vous cachez pas derrière un alter ego mais vous racontez énormément de choses personnelles : le cœur passe ici avant l’estomac…
Oui, c’est un peu ça — c‘est bien dit, d’ailleurs. J’aime paraphraser Alain Chapel, dont j’admire le travail. C’était l’un des cerveaux de la Nouvelle Cuisine, il officiait comme chef trois étoiles à Mionnay dans l’Ain au nord de Lyon et il avait un restaurant étonnant. Il a écrit un bouquin qui s’appelait La cuisine c’est beaucoup plus que des recettes. Ben oui : la cuisine c’est beaucoup plus que des recettes, en fait. C’est des émotions, des histoires, des souvenirs, des anecdotes… C’est de la culture impalpable, du lien, de la transmission… Au moment de faire cet inventaire des recettes qui m’ont accompagné depuis ma plus tendre enfance, j’avais envie de dévoiler tous les petits récits, les petites histoires ; tout ce qui se cache derrière… C’est ça qui est intéressant dans une recette.
Depuis 13 ou 14 saisons que j’anime l’émission On va déguster sur France Inter, j’ai cette chance de recevoir la totalité du panorama de l’édition culinaire. Et souvent — je ne jette pas la pierre, parce qu’il y a beaucoup de bouquins super intéressants qui me passionnent, je suis moi-même collectionneur de livres de cuisine — il y a beaucoup de livres de cuisine qui sont aussi des catalogues de recettes un petit peu froids. Quand un auteur ou une autrice me raconte une recette par le menu, avec les ingrédients, les proportions, les étapes techniques, on a aussi envie de savoir ce qui s’est passé derrière, comment la personne est arrivée jusqu’à cette recette ; quel a été le cheminement.
Parce qu’une recette, c’est un petit bout d’identité qui fait des rebonds et des ricochets d’une génération à une autre, qui circule et se transporte, d’un ami à un autre, se transmet, se transmute et se transforme. C’est la versatilité de la recette qui me plaît, sa fragilité.
François-Régis Gaudry
J’ai acquis des recettes, je m’en suis approprié plein. Je suis un piqueur, un picoreur, un passeur de recettes. J’ai aussi cette chance d’être un passeur parce que j’ai des médias assez puissants derrière moi et que je touche du monde ; d’avoir ce petit patrimoine que j’ai fait mien mais qui a des origines assez diverses. D’écrire ces recettes, c’était la moindre des choses : pour rendre à César ce qui lui appartient, de raconter les emprunts, le cheminement et comment je les ai mises à ma sauce. Comme je les ai transformées, adaptées ; comment j’ai enlevé du sucre, comment j’ai ajouté du paprika…
Votre patrimoine culinaire, en l’occurrence, doit beaucoup à votre grand-mère…
On à tous deux, trois, cinq recettes qui vous constituent ; la plus ancienne dont on se souvient ; celle qui vous émeut le plus ; celle qui vous rappelle un bon souvenir… On a tous ce patrimoine qu’on peut tous transmettre à ses enfants ou à ses amis. Et c’est un patrimoine qui circule. Ma grand-mère de Corse n’avait pas de patrimoine matériel. J’ai hérité de quelques trucs, des objets de cuisine dont j’ai pris la photo dans le bouquin — dont une roulette qui ne servait pas à découper la pâte mais les canistrelli que ma grand-mère faisait avec des graines d’anis. Elle m’a laissé, avec ses recettes, un legs inestimable à mes yeux.
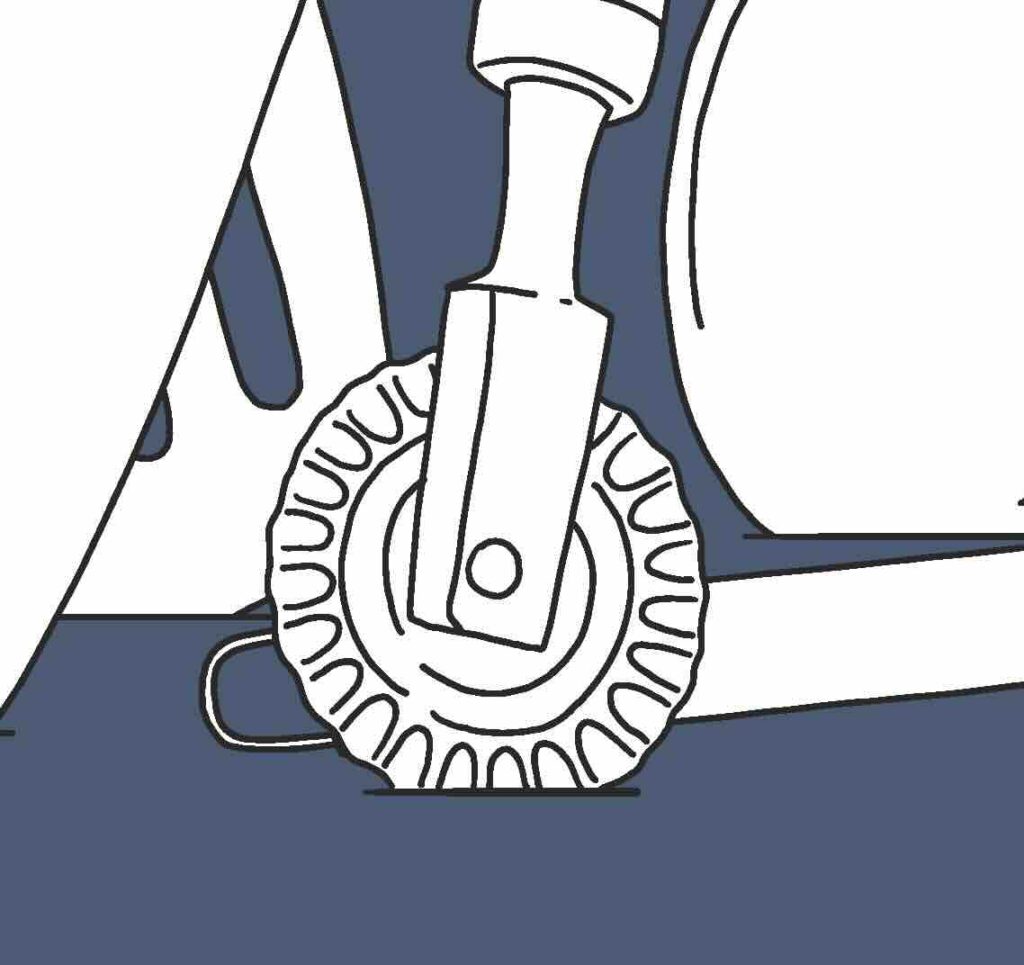
Vous pensiez d’ailleurs être son petit-fils préféré parce qu’elle vous cuisinait votre plat favori ; or vous avez découvert plus tard qu’elle cuisinait à chacun de ses petits-enfants son plat favori… C’est encore une preuve que la cuisine nous renvoie directement à l’affectif, vient toucher des émotions. Et qu’un plat est fait pour être partagé : il n’y a pas de cuisine sans cette idée de partage.
Exactement. On ne cuisine pas pour soi — moi perso, je ne cuisine pas pour moi. Il y a des gens qui aiment : ma femme, par exemple, quand elle est seule à la maison et que je suis en voyage, elle aime bien se faire un truc pour elle. C’est une espèce de plaisir égoïste, de plaisir solitaire — pourquoi pas ? En général, la cuisine, c’est une langue, un langage, un élément de partage, un outil de convivialité, de commensalité… Et puis, c’est aussi, je pense, une langue maternelle. Attention, on n’est pas obligé de savoir bien cuisiner pour aimer ses enfants et pour aimer ses proches. Mais, bien cuisiner pour ceux qu’on aime, il y a un truc très fort. Et ma grand-mère, c’était à la fois une nourrice et une matrice.
Quand j’essaie de m’interroger sur l’éveil de mon goût, comment il est né, comment c’est arrivé, je me tourne forcément vers ma grand-mère.
François-Régis Gaudry
Alors, ça peut paraître un peu bisounours, parce qu’il y a beaucoup de chefs trois étoiles, dans les reportages à la télévision, qui ont fait le coup de la grand-mère. Cette espèce d’icône, de figure tutélaire, qu’on convoque toujours. La réalité, c’est que j’ai eu la chance d’avoir une grand-mère qui était une incroyable cuisinière. Et je le dis très objectivement parce que, souvent, on est un peu déformé. Forcément, sa grand-mère, elle a fait les meilleurs gâteaux du monde, la meilleure soupe, le meilleur mijoté, parce qu’on est prisonnier — otage — de ses recettes pendant des décennies.
J’ai perdu ma grand-mère en 2007 mais ses recettes n’ont jamais été enterrées ; elles sont restées très vivantes parce ma mère a continué à en faire vivre beaucoup. Et quand j’y repensais avec mon recul de journaliste gastronomique, raisonnablement, je pouvais me dire que ma grand-mère était une cuisinière hallucinante. Elle avait maîtrisé toutes les techniques dans les livres. Elle savait dépecer un sanglier entier que mon grand-père apportait de la chasse ; préparer des grands plats de cuisine bourgeoise, comme du vol-au-vent, en faisant son propre feuilletage. En même temps, elle était capable de déchirer une fiche recette dans Femme Actuelle ou dans le petit fascicule d’un appareil électroménager Seb pour choper une recette plus ménagère — le poulet Calvi.
Elle faisait, évidemment, aussi cette cuisine paysanne… Cette cuisine de peu qu’on trouve en Corse qui m’émeut beaucoup, que j’ai retrouvée en Italie — un pays que je connais très bien — plus globalement, que j’ai rencontrée en Afrique du Nord, au Liban, dans des pays méditerranéens où j’ai eu la chance de voyager. Je suis très sensible à cette cuisine-là, cette diète méditerranéenne, avec très peu de protéines animales, beaucoup de légumineuses qui nourrissent de façon très frugale.
Tout ça pour dire que ma grand-mère avait besoin d’aimer par la cuisine. Mais aussi d’être aimée en retour. Lorsqu’elle nous servait un plat et qu’on était tous les cousins, qu’on commençait à faire des blagues, ma grand-mère en bout de table avait un regard un peu triste et lançait à toute la tablée, avec un accent corse : « alors, vous ne me dites rien ? —C’est bon mamie. Mais on te l’a dit dix fois que c’est bon parce que ça fait trente-six fois qu’on mange la même recette. Donc, on sait que c’est bon. On a encore besoin de te le dire ? » Et elle avait besoin de ce “retour sur investissement“ en quelque sorte. C’est une langue réciproque, la cuisine.
Tout chef aujourd’hui, quel qu’il soit, chef de la cuisine ordinaire ou grand chef, a aussi besoin de ce retour…
Il a besoin du retour des clients, absolument. On cuisine pour faire plaisir. Mais on cuisine aussi un tout petit peu pour flatter son ego — il n’y a pas de mal à ça. Après tout, un cinéaste a envie d’avoir beaucoup de spectateurs dans les salles obscures. On a envie d’être aimé par la cuisine. Je pense d’ailleurs que beaucoup des gens qui font la cuisine ont un certain ego, une certaine idée d’eux-mêmes ; ils ont envie de faire plaisir, de recevoir des compliments. Mais quoi que plus naturel ? il n’y a rien d’indécent ou de malsain à ça, au contraire !
Vous écrivez d’ailleurs que les chefs, avec (ou malgré) cette part d’ego qu’ils ont, acceptent toujours de vous confier une recette quand vous leur en demandez une.
Ouais… Franchement. Et je me méfie des gens qui disent : « Non, cette recette, c’est un secret, je ne la partage pas » Ça dit quelque chose de leur humanité. Alors, il peut y avoir une espèce de pacte familial, où l’on décide que la recette ne sortira pas de la famille pour des questions de superstition, ou parce que c’est une tradition de la garder secrète — je peux l’entendre. Ou quand des entreprises ont fondé toute leur aventure artisanale sur un secret de fabrication d’un produit précis, je peux carrément entendre que ce soit gardé secret. Si vous allez en Isère, vous n’arriverez jamais, même sous la torture, à obtenir la recette de la Chartreuse, même en torturant les pères Chartreux (rires). Cette formule est restée secrète et c’est tant mieux. Ça participe de la magie et de la mythologie de ce produit.
Les recettes se partagent. Je n’ai jamais rencontré un chef qui m’a dit : « Je la garde pour moi. » Au contraire, il y a même une certaine fierté des chefs de voir qu’un petit bout de leur patrimoine va être diffusé. En plus, quand ils la donnent à un journaliste qui a un peu d’influence — je ne vais pas dire qu’ils en ont vu d’autres — mais ils sont un peu flattés, c’est normal. Tous les chefs que je suis allé voir en disant : « Ton plat ou ton tour de main est absolument dingue. Comment tu fais cette sauce à l’orange ? C’est carrément dingue.— Attends, je te montre. », j’ai senti un certain contentement à me délivrer leur secret. C’est presque une forme de récompense. Pas parce que c’est Gaudry : si vous avez l’habitude d’aller au restaurant et que vous demandez à un chef comment il fait ci ou ça, peut-être qu’après, à dessein, il ne vous dira pas forcément tout. Mais en général, il prendra plaisir à décrypter un plat pour vous.
Il n’y a pas d’instinct de propriété ?
Il n’y a pas de copyright dans la cuisine ; il y a des inventeurs : le saumon à l’oseille, c’est à peu près identifié que les frères Troisgros l’ont créé en 1962-1963. Après, est-ce qu’ils ont été les premiers à associer l’oseille — cette herbe particulièrement acide — qui a le bon goût de contrebalancer le gras du saumon ? Ça, c’est une espèce de mystère. Après, celui qui interprètera différemment l’accord oseille-saumon, parce qu’il est vrai que ça marche très bien, on ne le soupçonnera pas d’avoir piqué la recette des Troisgros, sauf si vraiment il copie l’exact dressage. Mais la cuisine est faite d’influences, d’inspirations.
Je me souviens qu’un jour, Alain Passard, que je connais bien — trois étoiles à l’Arpège, rue de Varenne dans le 7e arrondissement de Paris, une des tables où je suis le plus allé — à un moment donné, il fait une invention géniale : sa tarte “bouton de rose”. Grand génie du végétal, Alain Passard a l’idée de mettre sur une pâte feuilletée des lamelles de pommes enroulées créant comme une espèce de bouquet de fleurs. Il a trouvé ça tellement génial — il s’aime beaucoup, Alain Passard, et en même temps, c’est un très bon cuisiner — qu’il s’est dit : « Je vais la déposer à l’INPI ». Or il n’a jamais réussi à la déposer, parce qu’une recette ne se dépose pas. Elle appartient à un chef ; des journalistes, des observateurs, des goûteurs, des gourmets sont là pour authentifier l’origine d’une recette. Mais légalement, elle ne lui appartient pas. Après, il s’en est pris à des chefs qui ont fait à peu près la même chose — ce n’est pas forcément de bon goût quand on est chef et de copier Passard. Mais cette tarte est devenue finalement une source d’inspiration, qui a donné naissance à bien d’autres variations.
Puisque vous évoquez une tarte, vous en décrivez une autre votre livre : la tarte à l’abricot de Michel Guérard. Il s’agit également une réinvention totale d’un basique de la cuisine…
C’est vrai. Parfois, vous êtes au restaurant, en voyage… Et puis vous avez comme une épiphanie : c’est-à-dire que tout à coup, ça fait tilt dans votre palais ; vous vous dites : « mon Dieu, quelle émotion ! » Beaucoup de gens disent : « J’en ai pleuré ! » Moi, je n’ai jamais versé ma larme devant un plat — je vais éventuellement avoir les poils qui se dressent. Mais c’est vrai que le 23 juin dernier, j’ai eu la chance d’être invité par Michel Guérard ; le 19 août de cette même année, malheureusement, il a cassé sa pipe. C’était un chef auquel j’étais très attaché, avec lequel j’avais développé une relation très intime. C’était un chef extraordinaire, d’une grande humilité. J’ai eu beaucoup de peine quand il est décédé.
On fêtait les 50 ans de la création des Prés d’Eugénie, dans les Landes, à Eugénie-les-Bains. Et Michel Guérard, c’est un des grands chefs de la Nouvelle Cuisine. Ce fut dans les années 1970, un chef qui a été mis en couverture du Time, dont les bouquins se sont vendus dans le monde entier. La Grande cuisine minceur, ça a été un best-seller aux États-Unis. C’était quelqu’un de vraiment étonnant et un très grand chef. Paradoxalement, pas le plus médiatique ; il avait d’ailleurs des relations un peu compliquées avec un certain Paul Bocuse, tous les deux se tiraient un peu la bourre.
Je suis donc allé là-bas. On était une quarantaine d’invités dont Alain Ducasse, Michel Troigros et sa femme, Olivier Roellinger J’étais assis à côté de Daniel Boulud, et à la gauche de Michel Guérard, qui était très très fatigué. Je savais que je n’allais plus le revoir vivant.. Mais il avait quand même puisé au fond de lui quelques forces pour faire cette fête. Et il nous a servi, par l’intermédiaire de son chef, cette tarte à l’abricot qui est juste phénoménale. Des oreillons d’abricot bergeron bien charnus, bien sucrés posés comme ça, boum ! sur une pâte sablée très très beurrée un peu épaisse, avec des amandes effilées. Les oreillons avaient préalablement, gentiment confit dans un sirop romarin. C’est une tarte extraordinaire, assez accessible que j’ai adorée. Dans le livre, c’est la recette — un peu simplifié— que m’a donné Michel Guérard effectivement, un mois et demi avant sa mort.
Sur un autre sujet, vous évoquez dans Recettes & Récits l’approche que vous avez faite de la gastronomie via “deux cuisines” : la cuisine privée et la cuisine publique, L’une féminine et l’autre masculine…
Oui. Même s’il ne faudrait ne pas pouvoir genrer la cuisine parce que ça fait un peu mal de dire ça.
Ça a quand même changé aujourd’hui, non ?
Oui, oui ça a changé. D’ailleurs, maintenant, heureusement, ça se rééquilibre dans les foyers. De plus en plus d’hommes sont aux fourneaux et ont le rôle nourricier qui était autrefois imposé aux femmes, il faut quand même être clair — c’est l’Histoire et nos sociétés patriarcales qui ont imposé aux femmes ce rôle nourricier. Et à l’inverse, il y a des femmes qui ont décidé de se donner des ambitions.
En étant aux premières loges de la scène gastronomique mondiale, je me rends bien compte à quel point les femmes prennent du pouvoir dans la gastronomie ; c’est une heureuse nouvelle.
François-Régis Gaudry
Je vois émerger des jeunes femmes qui font un travail prodigieux et qui bâtissent des vrais répertoires culinaires.
Mais c’est vrai qu’il y avait la cuisine du privé, qui était la cuisine des femmes et la cuisine publique, qui était la “vraie belle cuisine,” celle des hommes, qui détenaient le savoir culinaire, les techniques ; qui avait la capacité de diriger des brigade et aussi la part belle et la lumière. Parce qu’évidemment, les journalistes se sont beaucoup intéressés à ces cuisines de restaurants — donc à la cuisine des hommes. Et toutes les femmes qui nous ont nourris au quotidien — ma mère et ma grand-mère en ont fait partie — ne font plus partie de l’Histoire, elles ont été invisibilisées.

Il y a une recette vraiment géniale dans mon bouquin — je n’ai aucune difficulté à le dire parce que ce n’est pas la mienne — qui est une recette de poulet à l’estragon que je tiens d’Anne-Sophie Pic et qui m’émeut beaucoup.J’ai une relation très proche avec cette cheffe, on est de la même génération, on a toujours beaucoup échangé. Et quand je lui demande une belle recette, qui est chère à son cœur. Rendez-vous compte, Anne-Sophie Pic avait une arrière-grand-mère qui s’appelait Sophie, un grand-père qui s’appelait Jean-Pierre, un père qui s’appelait Jacques ; c’est une des plus belles dynasties gastronomiques de France et j’ai même envie de dire du monde. Le destin, la saga de la famille Pic est incroyable — c’est d’ailleurs ce qui nous permet d’être content d’être français aussi : cette excellence qui peut se transmettre de génération en génération, il n’y a pas beaucoup de pays qui en sont capables.
Quand je lui ai demandé la recette la plus chère à son cœur, elle me parle du poulet à l’estragon qui n’était ni de son père, ni de son grand-père, ni sa grand-mère, mais de sa mère, Suzanne. Dont personne, aucun journaliste n’a parlé. On parlait de Jacques Pic parce qu’il avait inventé en 1973 le loup au caviar, parce qu’il avait trois étoiles, parce que ça a été une des grandes figures de la Nouvelle Cuisine, mais Suzanne, c’était qui ? C’était la femme de…. Et en même temps, c’était la femme qui nourrissait bien au quotidien. Et Anne-Sophie, elle s’en souvient.
Je ne vais pas faire de démagogie et dire que la cuisine des grands chefs ne m’intéresse pas etc.. J’ai vécu des émotions vraiment bouleversantes dans plein de restaurant étoilés. Mais cette cuisine du quotidien, cette cuisine un peu invisibilisée de la sphère privée comme vous dites, c’est une cuisine éminemment sensible et intéressante qui avait en plus la fonction de nourrir bien ; d’être domestique, d’être anti-gaspi avant même que l’expression n’existe. Et qui était aussi nutritionnellement super équilibrée.
Vous consacrez une belle place à la cuisine du quotidien, à l’art d’accommoder les restes, de se débrouiller avec les fonds de tiroirs ou de frigo — l’exemple de votre invention des “railllettes”, rillettes avec de l’aile de raie. Mais vous n’oubliez pas de rendre hommage à l’une de vos obsessions : la carbonara !
Ouais… (sourire) ça me colle à la peau parce que c’est une des recettes que je fais le plus souvent et que ma famille me réclame le plus. J’ai toujours été sensible à la cuisine italienne parce que ma mère aussi l’a été. J’ai un cousin germain italophone, italophage et italophile dont je suis très proche, Stéphane Solier, qui est corse, professeur de lettres agrégé et qui a vécu pendant plus de 10 ans à Rome. Maintenant, il travaille avec moi, on l’entend régulièrement sur les ondes France Inter. notamment sur les questions italiennes et littéraires. Et il avait un appartement au Vatican parce qu’il travaillait au Palais Farnèse parce qu’il était attaché culturel à l’ambassade de France — il y a pire comme métier ; mais il l’avait mérité, il a fait des grandes études.
J’allais le voir souvent le week-end et il m’emmenait dans des trattorias à Rome ; l’avantage, comme j’étais étudiant à Sciences Po et que je n’avais pas beaucoup d’argent, c’est que ça coûtait 7, 8 euros ; c’est formidable, vive l’Italie ! Et j’ai découvert ce drôle de plat que je prenais pour un truc de brasserie du coin de la rue. Si vous vous baladez à Paris ou à Lyon, vous verrez la carbonara au saumon fumé, à la crème, aux pâtes fraîches… On voit toutes les déclinaisons ! Il y a de quoi vraiment provoquer des attaques chez nos amis italiens.
J’ai un peu percé le secret de la vraie bonne carbonara quand j’étais à Rome. La bonne carbonara peut effectivement se passer de crème. Je ne vais pas appeler la police si je suis devant quelqu’un qui met de la crème fraîche dans sa carbonara, mais j’essaie de montrer dans ma recette que de ne pas mettre de crème, non seulement c’est une économie en termes de matière grasse, mais en plus, c’est tout autant de crémosité dans la sauce et c’est plus d’intensité en termes de goût. Parce qu’en fait, avec le pouvoir liant du fromage fondu — du pecorino romano ou du parmesan — l’amidon contenu dans l’eau des pâtes, — parce qu’il faut se servir un tout petit peu de l’eau des pâtes pour faire la mantecatura, c’est-à-dire la liaison de la sauce — plus évidemment le jaune d’oeuf, tout ça fait qu’on arrive à obtenir un crémeux absolument phénoménal, donc vive la carbonara. Et la crème est un crime ! (rires)
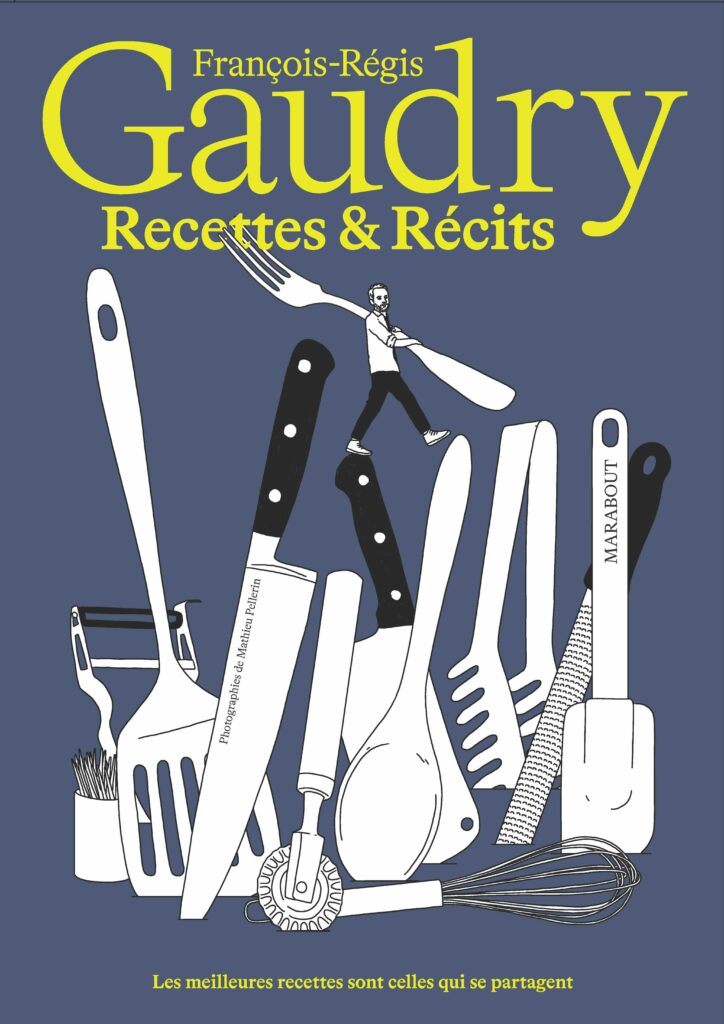
Recettes et récits – Les meilleures recettes sont celles qui se partagent, François-Régis Gaudry, 352p., (3h de lecture et des heures de dégustation !), 35€.
















