Et si les géants des GAFAM décidaient de s’emparer d’un pays pour ne plus avoir à obéir aux réglementations imposées par ceux où ils sont actuellement implantés ? Loin d’être absurde, cette idée est au cœur de D’or et de jungle, captivant (et alarmant) roman d’aventures de l’académicien, par ailleurs ex diplomate, Jean-Christophe Rufin. Une analyse non dépourvue d’humour sur les risques potentiels encourus par nos fragiles États…
Vous avez été ambassadeur entre 2007 et 2010. “Son Excellence Jean-Christophe Rufin” aurait-il eu la liberté d’écrire ce roman ?
Jean-Christophe Rufin : Ah non, vraiment. C’est pour cela que j’ai fait un passage dans la diplomatique très restreint et très rapide. Parce que c’est un métier où l’on est obligé de tourner sept fois sa langue dans sa bouche ; c’est très difficile de garder sa liberté.
Vous vous attaquez ici à un sujet de géopolitique (à peine) fiction. Mais plutôt que de prendre un État fictif, vous en avez choisi un bien réel — le sultanat de Brunei — et des dirigeants tout aussi réels, en précisant toutefois dans le préambule comme la postface que vous tordiez légèrement la réalité. Pourquoi ?
L’idée, c’est de raconter une histoire. Moi, j’écris les romans classique, dans le sens où je ne cherche pas à travailler sur la forme du roman. J’utilise cet héritage merveilleux des auteurs du XVIIIe, XIXe et XXe siècle, qui nous ont légué cet outil extrêmement puissant du roman d’aventures. Et je l’applique au présent. Si Alexandre Dumas revenait parmi nous, eh bien, je pense qu’il s’intéresserait à son temps. Il n’a pas écrit que des livres d’Histoire. Quand on demandait quels étaient ses modèles à un auteur anglo-saxon comme John le Carré, qui scrutait lui aussi le présent, il citait Alexandre Dumas, Victor Hugo, Flaubert, Maupassant….
On a donc ce héritage extraordinaire. Et il faut l’appliquer à quelque chose qui soit réel. Parce que si l’on commence à inventer la scène sur laquelle se déroule une action, ça n’a pas le “même goût”. Marguerite Yourcenar disait : « un roman historique doit être juste, exact ; tout doit être cohérent et documenté. Sinon, c’est un bal costumé. » Si on écrit sur le monde d’aujourd’hui, mais en créant une espèce de monde parallèle, finalement on manque sa cible. Je préférais donc ancrer les choses dans un lieu et j’ai choisi le sultanat de Brunei parce que je pense que beaucoup ne sont pas allés passer leurs vacances là-bas ; je ne le conseille pas d’ailleurs.

Mais c’est quand même un lieu qui me faisait rêver depuis longtemps. D’abord parce que c’est dans ce monde malais, cette zone de la mer de Chine méridionale qui est une sorte de Méditerranée asiatique, entre la Chine au nord, l’île de Bornéo au sud, les Philippines à l’est et la Malaisie et Sumatra. Un lieu d’échanges de peuples depuis des siècles, avec une présence de communautés européennes très diverses : des Hollandais, des Anglais, des Français, des Espagnols… Un lieu que je trouvais très attirant. Je n’allais pas me priver de ces couleurs ni de ce parfum très particulier que donne justement un pays qui nous apporte sa réalité. Je n’aurais pas été capable, d’ailleurs, d’inventer un pays aussi singulier, aussi riche.
D’or et de jungle est quand même un roman d’histoire contemporaine ou d’histoire immédiate, voire de prospective. Et il se révèle très transparent : on devine que la méthodologie de vos personnages préparant un “coup d’État clefs” en mains à Brunei est le reflet de la vôtre, au moment de la fabrication du roman…
Oui, et d’ailleurs, on est allé sur place avec ma compagne — parce que je n’aime pas parler d’un pays dans lequel je ne me suis pas rendu. On y est allé dans la perspective de faire un coup d’État [littéraire, NDR] (sourire). Alors, c’est un peu particulier : on ne l’a pas crié sur les toits ! Quand on passait sous un pont, on se disait : « ah, on peut mettre les explosifs ici. » (sourire)
C’est très amusant de se mettre dans la peau d’une partie des personnages — ceux qui sont sur place, les autres vont agir à distance. Ceux qui sont sur place sont un peu dans notre situation, c’est-à-dire qu’ils arrivent dans un pays et se demandent comment faire éclater tout ça. On se plaçait dans la position d’insurgés — après, on n’était que deux, on n’allait pas arriver à grand-chose ! Mais un pays, même s’il est très petit — Brunei fait à peu près la taille d’un départements français ; il y a 300 000 personnes dans la capitale comme dans tout le pays d’ailleurs ; il est très riche par le pétrole pour le moment — comment peut-on faire, finalement, pour le transformer ?
La thématique du coup d’État a toujours inspiré les écrivains : Cicéron (La Conjuration de Catilina, Machiavel, Malaparte avec un livre qui lui a valu beaucoup d’ennuis, Technique du coup d’État. Malaparte, qui était vraiment un grand écrivain, était fasciné par cette idée de l’insurrection et du coup d’État. Plus près de nous, un livre de Edward Luttwak a fait date à fin des années 1960. Alors là, c’est carrément un manuel — c’est “le coup d’État pour les nuls” ! (sourire) Il s’appelle d’ailleurs Coup d’État : A Practical Handbook et contient des schémas très pratiques vous permettront, le jour où vous aurez encerclé le palais présidentiel, de savoir où placer les chars, comment faire une première déclaration après la prise de pouvoir… On a d’ailleurs retrouvé ce livre dans les bagages d’un certains nombre de candidats au coup d’État s’étant mal débrouillés. Par exemple, le général Oufkir, au Maroc, l’avait annoté.
Et puis il y a cette littérature très abondante de Trotsky qui, à la différence de Lénine, était beaucoup plus intéressé par la mécanique de la prise du pouvoir. Lénine pensait qu’il fallait que les sociétés soient mûries par la propagande révolutionnaire et que les conditions de la Révolution n’étaient pas réunies ; Trotsky disait que c’était une question de technique : quelques personnes bien formées, qui savent s’y prendre, peuvent prendre le pouvoir.
Rassurez-vous, ce livre est un roman, ce n’est pas un cours sur le coup d’État ! (…) sinon j’aurais rédigé un essai, un truc bien emmerdant.
Jean-Christophe Rufin
Mais rassurez-vous, ce livre est un roman, ce n’est pas un cours sur le coup d’État ! Et je n’y ai pas porté un intérêt d’un point de vue abstrait ni théorique — sinon j’aurais rédigé un essai, un truc bien emmerdant (sourire). L’idée c’est vraiment de vivre les choses par l’intermédiaire des personnages. Le grand privilège du roman, c’est l’incarnation. Par l’identification des personnages, en ignorant tout d’une situation, vous pouvez entrer en symbiose avec les événements, les comprendre et vivre les émotions qu’ils vivront. C’est toute la différence entre les faits et le roman. Peu importe sur quoi porte l’étude, finalement.
Le grand auteur de romans historiques Walter Scott a fait des préfaces pour presque tous ses romans. Elles sont très intéressantes parce qu’elles donnent un peu une vision technique de son travail. Dans l’une d’elles, il disait : « peu importe qu’on décrive le monde passé, le monde présent ou le monde futur, les mécanismes sont les mêmes. Il s’agit de faire entrer ces lecteurs dans une réalité qui n’est pas la leur, un monde qui n’est le leur. » Soit un monde passé, qu’il n’a pas vécu, soit un monde futur qui n’est pas encore là, soit un monde d’ailleurs, différent — c’est le cas dans ce livre — dont il peut ne pas être familier mais qu’on apprend à connaître en travers les personnages.
La plupart de vos personnages principaux (Flora, Ronald…) possèdent plusieurs nationalités, plusieurs passeports. Est-ce parce que les frontières géographiques n’ont aucune emprise sur eux qu’ils sont plus enclins à imaginer d’autres formes de gouvernance ?
Je n’ai pas réfléchi là-dessus, je ne sais pas… Ça me paraissait important de raconter une histoire qui soit très internationale, qui se déroule dans de nombreux endroits – même si l’épicentre, c’est ce sultanat de Brunei. En effet, les personnages sont tout de même habitués à traverser le monde et les cultures.
S’agissant de Flora, qui est le personnage principal du livre, elle est un peu le mélange de deux femmes que je connais. L’une est une ancienne championne de plongée en apnée qui a très tôt battu des records et qui aujourd’hui encadre des croisières. Ces croisières ont toujours une dimension sportive, mais les croisiéristes ne sont pas forcément des champions — j’ai pu constater, en embarquant sur ces bateaux, que la performance était surtout gastronomique (sourire). Flora est aussi nourrie d’une autre amie : la fille d’un mercenaire français très célèbre, Bob Denard. En dotant Flora d’un grand-père mercenaire, j’ai fusionné les deux femmes pour en faire une seule personne.
Je trouvais intéressant que, dans une histoire où l’on croise beaucoup de gens un peu cyniques, mus par des considérations financières ou de pouvoir, Flora introduise quelque chose d’autre. L’aventure dans laquelle elle va se trouver embarquée fait référence pour elle, peut-être inconsciemment, à ce grand-père, sorte de chevalier égaré dans le XXe siècle. Parce que Bob Denard, c’était un peu n’importe quoi : une sorte de soldat perdu, qui a tout gagné, tout perdu, très peu recommandable, mais avec une geste.
Sa fille racontait que sur la fin, il était atteint par la maladie d’Alzheimer. Il se perdait chez lui, il était incapable de mettre ses chaussures dans le bon sens. Mais les Africains continuaient à l’appeler pour lui demander des conseils et faire la révolution dans leur pays. Alors, pendant deux heures, il leur donnait des conseils, il expliquait comment il fallait s’y prendre pour faire la révolution ; il proposait bien entendu de prendre la tête de l’insurrection alors qu’il n’était pas capable de mettre ses chaussures. Et sa femme : « qu’est-ce que vous voulez que je vous dise : ça lui fait du bien… » Si ça lui faisait du bien à lui, je ne suis pas sûr qu’il ait fait du bien à ceux qui l’ont écouté…
On n’est pas du tout dans cette logique fragile pour ces agences de sécurité que je décris. Les gens qu’on y rencontre sont beaucoup moins poétiques et beaucoup moins désintéressés que ça. Flora l’est, donc elle permet de mettre dans le récit une sorte de contrepoint très poétique et romantique.
Ces agences, ces officines, ont-elles pignon sur rue ou bien se terrent-elles dans une forme de discrétion qui sert leurs intérêts ?
Un petit peu les deux. Il faut que les gens sachent qu’elles existent mais, parfois, elles prennent un aspect un petit peu décalé. Par exemple, en Afrique du Sud, une de ces boîtes qui s’appelle DAG, est officiellement déclarée comme d’anti-braconnage. Donc, elle protège les éléphants etc. Sauf qu’elle les protège avec des hélicoptères, des mitrailleuses lourdes… Et que, par exemple, dans le Mozambique voisin, quand il y a eu une offensive en 2021 des groupes islamiques qui étaient sur le point de faire tomber la capitale régionale, ils ont arrêté l’insurrection avec trois hélicoptères. Mais ils ne vont pas jusqu’à se présenter comme des mercenaires. On rencontre très rarement quelqu’un qui vous donne sa carte de visite sur laquelle il y a marqué “mercenaire” ; il y a toujours quelque chose de plus honorable.
Mais ces agences existent. On a beaucoup parlé de Wagner : c’est une agence un peu particulière, parce que c’est une création du gouvernement russe, en fait. Mais on a vu quand même, avec la fin de Prigojine qu’ils avaient quand même leur autonomie. Il y en a beaucoup dans l’univers anglo-saxon, sud-africain, surtout, et ils sont capables de mener des opérations telles que celle décrite dans mon livre.
Ce qui se passe dans ce petit pays (…) est une version en petit, en concentré, de ce qu’on peut appeler la cyber-guerre, que vous pouvez trouver aujourd’hui sur des théâtres beaucoup plus larges.
Jean-Christophe Rufin
L’auteur que vous êtes n’est-il pas, à travers la fiction, une sorte de lanceur d’alerte ?
Oui, bien sûr. Cette espèce de description de ce qui se passe dans ce petit pays, qui va exploser grâce — ou à cause — de fausses infos, est une version en petit, en concentré, de ce qu’on peut appeler la cyber-guerre, que vous pouvez trouver aujourd’hui sur des théâtres beaucoup plus larges. Chacun sait qu’il y a eu des interférences, notamment d’origine russe, pendant les élections américaines et que les Chinois aussi utilisent beaucoup ces moyens de cyber-guerre à l’égard des pays dans le pourtour de Taïwan, pour y préparer une intervention qui est probablement inéluctable. Tous ces mécanismes, dans notre propre pays, existent de façon à influencer l’opinion publique par l’extérieur. Mais au fond, des mécanismes existent absolument partout.
Et à cet égard, on peut se désintéresser du destin de sultanat de Brunei, mais en réalité, tout ce qui lui arrive n’est que le reflet de ce qui arrive chez nous. Simplement, c’est plus clair, c’est plus facile à mettre en scène. Ça repose sur le fait qu’il y a un pays qui est constitué de communautés différentes : des Malais, des musulmans plus extrémistes et plus modérés, des Chinois plutôt bouddhistes, les peuples de la forêt…Vous avez toutes ces communautés qui sont mélangées, qui vivent dans une relative bonne intelligence, mais à un moment donné, par l’extérieur, on peut les dresser les uns contre les autres — et c’est ce qui se passe. L’autre jour, j’étais avec les journalistes belges, qui m’ont parlé de tout ça et qui m’ont dit : « finalement, ce que vous décrivez, c’est la Belgique ! » Pourquoi pas ? Mais il n’y a pas que la Belgique…
Il suffit d’une information envoyée au bon endroit, au bon moment, pour que beaucoup de choses puissent basculer.
C’est arrivé. Dans le coup d’État “traditionnel” — qui se fait toujours, hein, ça reste une valeur sûre ! — qu’on voit en Afrique par exemple, on a des militaires qui prennent d’assaut le palais présidentiel, la télévision, quelques points un peu stratégiques, puis le titulaire du truc est débarqué et on met un calife à la place du calife. En gros, la violence est exercée par un petit groupe. Mais si vous regardez bien, à quoi ça sert de prendre d’assaut la réseau télévision dans un pays ? Il y a beaucoup d’autres moyens de faire circuler l’information, et d’agir sur l’opinion publique sans la radio ni la télé d’État — qui sont des perroquets officiels. Vous n’avez pas besoin d’aller tirer sur les bâtiments, c’est très archaïque.
Si vous voulez des performances, prendre le contrôle de l’opinion par les réseaux sociaux, c’est beaucoup plus efficace et ça ne nécessite pas de violence. En revanche, ça peut déclencher une violence interne…
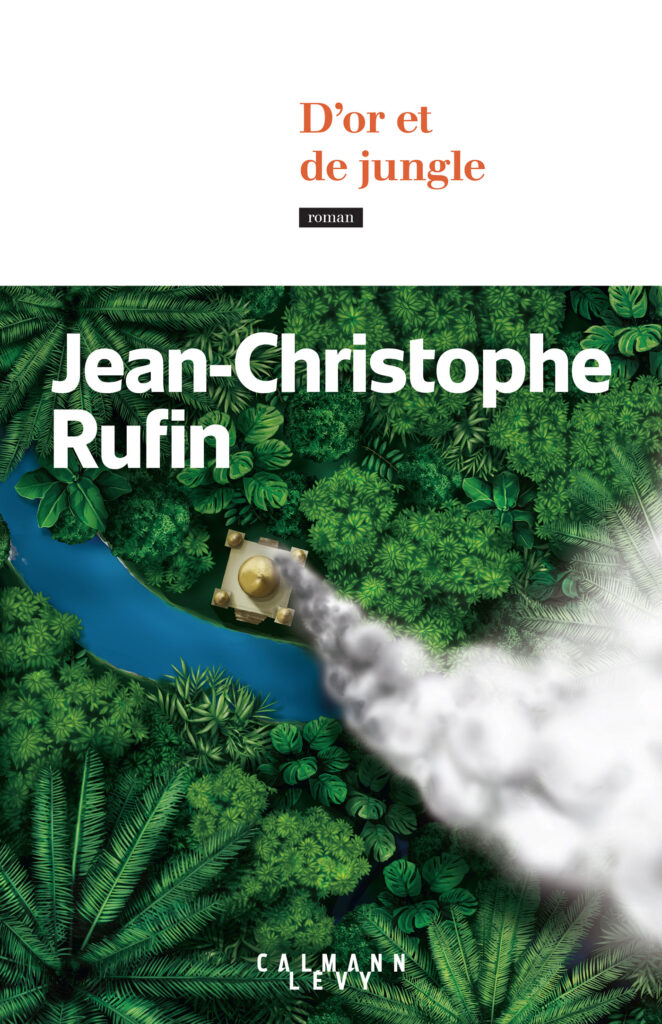
D’or et de jungle, Jean-Christophe Ruffin, Calmann-Lévy, 400 p. (8 heures de lecture), 22,50€.









